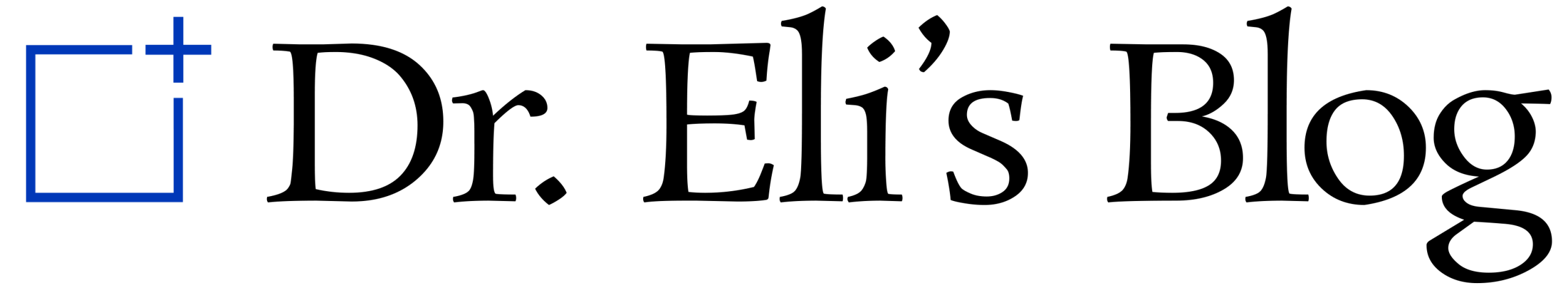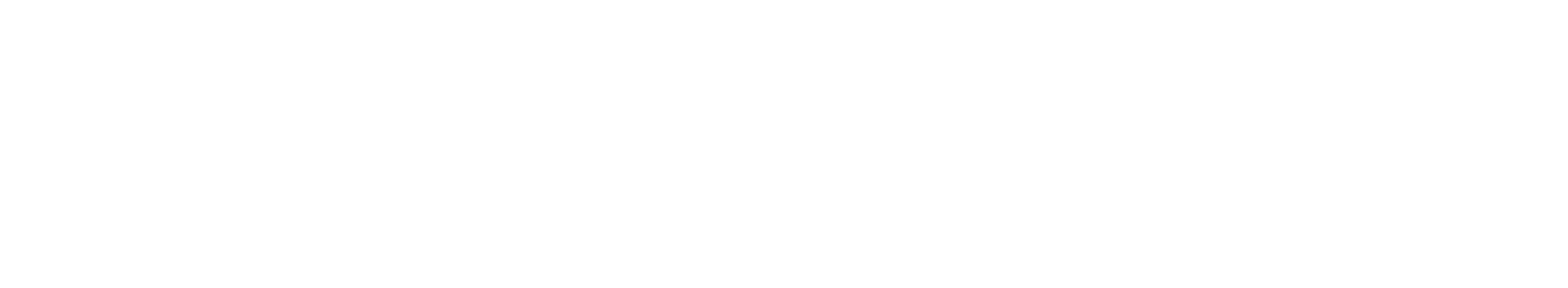Dans la Torah, nous rencontrons une tapisserie de personnages remarquables dont les vies éclairent la dynamique profonde de l’obéissance, de la foi et de l’intercession dans leur relation avec Dieu. Ces individus, souvent descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, sont célébrés pour leur obéissance sans faille aux ordres divins, façonnant ainsi l’héritage spirituel d’Israël. Néanmoins, parmi ces personnalités imposantes, un homme se démarque, distingué de manière unique dans le texte sacré : Noé, le seul individu explicitement appelé « homme juste » dans toute la Torah (Gen. 6:9). Cette désignation est frappante, non seulement en raison de sa singularité, mais aussi parce que Noé ne faisait pas partie de la lignée d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, les patriarches choisis pour fonder la nation sainte de Dieu, Israël. Si la justice de Noé est indéniable, ce sont les descendants de ces patriarches que Dieu désigne comme une « nation sainte » et un « royaume de prêtres » (Ex. 19:6). Cette reconnaissance soulève une question profonde : Pourquoi, malgré le titre de justice inégalé de Noé, n’a-t-il pas été inclus parmi les fondateurs du peuple élu de Dieu ? La réponse, selon moi, réside dans les différentes manières dont Noé et les patriarches ont approché Dieu, en particulier dans les moments de jugement divin, révélant des dimensions plus profondes de la foi, de l’intercession et de l’engagement relationnel avec le divin.
L’homme « oui » de Dieu
Pour explorer cette question, examinons tout d’abord la réponse de Noé à l’annonce du jugement de Dieu. Dans Genèse 6, Dieu révèle à Noé qu’un déluge catastrophique détruira la terre en raison de la méchanceté omniprésente de l’humanité. Dieu ordonne à Noé de construire une arche pour préserver sa famille et les représentants de chaque animal. La réponse de Noé est immédiate et sans équivoque : « Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné » (Gen. 6:22). Son obéissance est exemplaire, marquée par le silence et la conformité. Noé ne remet pas en question le décret de Dieu et n’intercède pas pour la génération condamnée. Sa droiture se manifeste dans l’exécution fidèle de l’ordre de Dieu, assurant la survie de sa famille et de l’ordre créé. Cette obéissance est profonde et reflète une grande confiance dans la justice et la souveraineté de Dieu. Cependant, l’approche de Noé est passive en termes d’engagement avec Dieu au-delà de la tâche assignée. Il accepte la volonté divine sans la contester, incarnant une forme de justice qui privilégie la soumission au dialogue.
L’ami lutteur de Dieu
En revanche, la seule personne dans toute la Bible hébraïque à être appelée l’ami de Dieu est Abraham (És 41:8, 2 Chron 20:7, Jacques 2:23). Pourtant, la réponse d’Abraham à l’annonce du jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe révèle une attitude étonnamment différente. Dans Genèse 18:16-33, Dieu informe Abraham de son intention de détruire les villes en raison de leur péché flagrant. Plutôt que d’accepter, Abraham engage avec Dieu un dialogue audacieux, presque téméraire. Il implore la miséricorde au nom des villes, espérant trouver ne serait-ce qu’un petit nombre d’habitants justes. Le langage d’Abraham est audacieux :
« Tu vas balayer les justes avec les méchants ? … Loin de toi l’idée de faire une telle chose… Le Juge de toute la terre ne fait-il pas ce qui est juste ? » (Gn 18, 23-25).
Il ne s’agit pas d’une simple conformité, mais d’un acte sacerdotal d’intercession, où Abraham risque le mécontentement divin pour défendre les intérêts d’autrui. Sa persévérance – négocier avec Dieu pour qu’il épargne les villes pour cinquante, puis quarante-cinq, jusqu’à dix justes – démontre une intimité relationnelle avec Dieu, une intimité qui ose se battre avec les intentions divines. En fin de compte, Abraham accepte la volonté de Dieu, comme Noé, mais seulement après avoir épuisé toutes les possibilités d’influencer le résultat. Cette position d’intercession s’aligne sur le rôle sacerdotal qu’Israël est appelé à incarner plus tard, en jouant le rôle de médiateur entre Dieu et les nations.
La famille de lutte de Dieu
L’étymologie du nom « Israël », qui provient de Jacob, le petit-fils d’Abraham, éclaire encore davantage le contraste entre Noé et Abraham. Le nom Israël (Yisrael) provient de la racine hébraïque שרת (sarat), qui signifie « lutter » ou « exercer une influence », comme le montre la Genèse 32:24-30, où Jacob lutte toute la nuit avec un personnage mystérieux, identifié plus tard comme divin. Refusant de lâcher prise jusqu’à ce qu’il reçoive une bénédiction, la ténacité de Jacob lui vaut le nom d’Israël, signifiant une lutte avec Dieu qui façonne son identité et celle de ses descendants. Cette lutte n’est pas une rébellion mais un engagement profond, une volonté de se confronter à la volonté divine tout en restant fidèle. La rencontre de Jacob fait écho à l’intercession d’Abraham, reflétant la tendance des patriarches à s’approcher de Dieu avec révérence et audace. Contrairement à l’obéissance silencieuse de Noé, la lutte de Jacob incarne une relation dynamique avec Dieu, qui implique le questionnement, la persistance et la transformation.
Ce modèle de lutte et d’intercession n’est pas propre à Abraham et Jacob, mais se retrouve dans d’autres personnages bibliques qui, comme les patriarches, s’engagent avec Dieu de manière à approfondir leur rôle dans l’alliance. Prenons l’exemple de Moïse, autre figure centrale de l’histoire d’Israël, dont les interactions avec Dieu illustrent cette approche. Dans Exode 32, après que les Israélites ont péché en adorant le veau d’or, Dieu déclare son intention de détruire le peuple et de repartir à zéro avec Moïse. La réponse de Moïse est immédiate et courageuse : il intercède, suppliant Dieu de se calmer.
« Pourquoi ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d’Égypte avec une grande puissance et une main puissante ? … Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : ‘C’était avec une mauvaise intention… Reviens de ton ardente colère, adoucis-toi et ne fais pas périr ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : « Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ; je donnerai à ta postérité tout ce pays que je leur ai promis, et il sera leur héritage pour toujours » (Ex. 32:11-13).
Moïse invoque même la réputation de Dieu parmi les nations et son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, exhortant Dieu à se souvenir de ses promesses. Moïse fait preuve d’audace en déclarant : « Si tu ne pardonnes pas leur péché, efface-moi du livre que tu as écrit » (Ex. 32:32), offrant ainsi sa vie pour le bien du peuple. Comme Abraham, Moïse joue le rôle de médiateur, s’interposant entre Dieu et Israël, et son intercession assure la miséricorde divine. Ce rôle sacerdotal, enraciné dans l’intimité relationnelle et le courage, s’aligne sur la vocation d’Israël en tant que nation de prêtres, distinguant l’approche de Moïse de la conformité fidèle de Noé.
Le ministère de Jésus s’aligne sur la trajectoire d’Abraham, et non sur celle de Noé, en incarnant l’intercession audacieuse et l’engagement relationnel avec Dieu. Comme Abraham, qui a plaidé pour Sodome, et Moïse, qui a intercédé pour Israël, Jésus est le médiateur de l’humanité, priant pour le pardon (Luc 23:34) et s’engageant dans la volonté de Dieu par un dialogue intime (Jean 17). Contrairement à l’obéissance fidèle de Noé, le rôle sacerdotal d’intercession de Jésus, qui est au cœur de sa mission, reflète la foi dynamique d’Abraham, luttant pour la rédemption, accomplissant la vocation d’Israël en tant que « royaume de prêtres » (Ex. 19:6). Tous les croyants de la nouvelle alliance, enracinés dans le Messie juif, suivent la voie vibrante d’Abraham, et non l’obéissance silencieuse de Noé. Jésus en est l’exemple, intercédant hardiment pour l’humanité, nous invitant à nous engager avec courage auprès de Dieu, et se faisant le médiateur de son amour et de sa justice illimités pour le monde. Aujourd’hui, nous sommes appelés à imiter Jésus, en embrassant une foi dynamique qui lutte, aime férocement et fait profondément confiance, façonnant l’histoire comme un royaume de prêtres rayonnant de la grâce transformatrice de Dieu.
Conclusion
La justice singulière de Noé est un phare d’obéissance, qui a préservé l’humanité en se conformant de manière inébranlable aux ordres de Dieu. Néanmoins, les patriarches – Abraham, Jacob et Moïse – incarnent une foi dynamique qui mêle soumission et intercession audacieuse, luttant avec Dieu pour façonner ses desseins rédempteurs. Leur courage de dialoguer, de plaider et de lutter reflète une profonde confiance dans la justice et la miséricorde de Dieu, forgeant Israël comme une nation sainte et un royaume de prêtres. Cet héritage nous met au défi d’embrasser une foi qui ne se contente pas d’obéir mais qui s’engage, qui ose intercéder et qui fait confiance au cœur relationnel de Dieu. En tant qu’héritiers de cet appel, nous sommes invités à nous tenir dans l’intervalle, à servir de médiateurs pour l’amour et la justice de Dieu dans un monde qui en a besoin. Comme les patriarches, luttons hardiment, aimons farouchement et faisons profondément confiance, façonnant l’histoire par une foi qui ose s’associer au Divin.