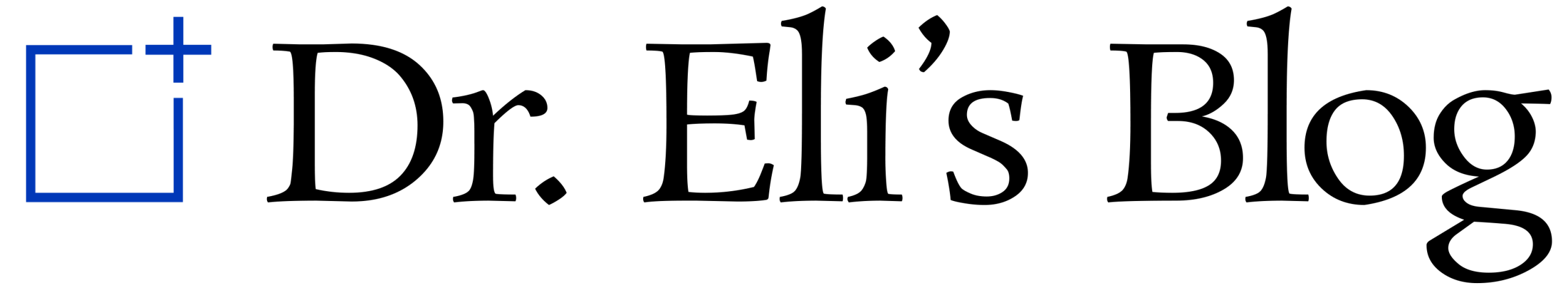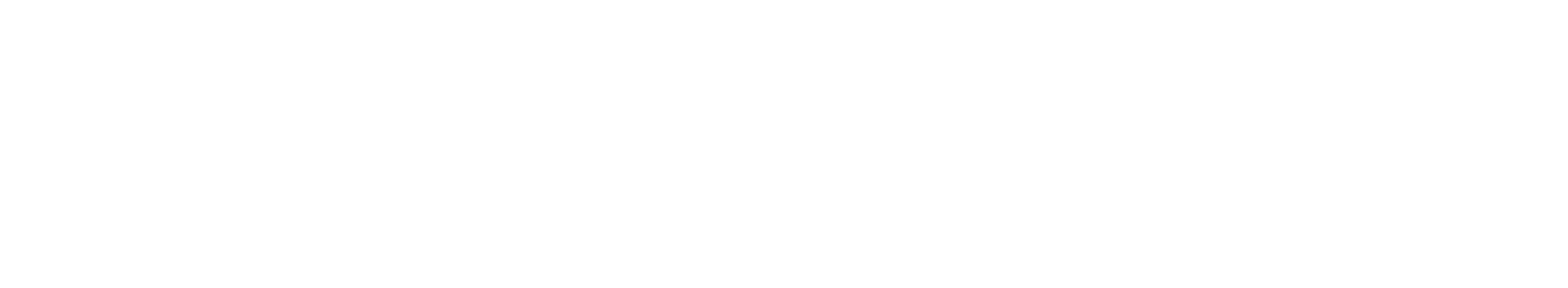L’histoire commence avec Saraï, l’épouse d’Abram, qui est confrontée au profond chagrin de la stérilité dans une culture où le fait d’avoir des enfants est une mesure centrale de la valeur d’une femme (Gn 16,1). Le mot hébreu désignant la stérilité de Saraï, ‘aqarah (עֲקָרָה), traduit non seulement une stérilité physique, mais aussi un vide existentiel profond, un vide qui fait écho à son rôle non rempli dans la promesse de Dieu à Abram. Après des années d’attente de la réalisation de la promesse de Dieu de faire d’Abram le père d’une nation puissante, Saraï, dans son désespoir, a proposé une solution culturellement acceptable mais émotionnellement difficile : elle a offert son esclave égyptienne, Agar, à Abram en tant que mère porteuse (Gn 16, 2). L’expression hébraïque l’ishah (לְאִשָּׁה), souvent traduite par « en tant qu’épouse », suggère que le rôle d’Agar était plus qu’une simple concubine ; il avait un poids juridique dans le Proche-Orient ancien, liant Agar à la maison de Saraï tout en compliquant son statut.
Agar est tombée enceinte après son union sexuelle avec Abram (Gn 16, 3-4). Le texte hébreu indique que la grossesse de Hagar l’a amenée à « regarder Saraï avec mépris ». Cette phrase suggère un changement subtil dans le comportement de Hagar, peut-être un nouveau sentiment de valeur ou de défi, car son ventre portait l’héritier que Saraï ne pouvait pas porter. Cela a suscité le ressentiment de Saraï, décrit en hébreu comme ‘enah (עֵינָה), un terme lié à l’affliction ou à l’oppression, révélant la profondeur de l’orgueil blessé de Saraï. Le traitement sévère infligé par Saraï à l’Égyptienne Agar fait écho à l’oppression ultérieure d’Israël en Égypte, laissant entrevoir un modèle cyclique de souffrance humaine (Gn 16,6). Se sentant humiliée et impuissante, Agar s’enfuit dans le désert, cherchant à échapper à la cruauté de sa maîtresse.
Première rencontre divine
La fuite d’Agar dans le désert marque un moment décisif, car elle introduit la première de plusieurs interventions divines. Près d’une source sur le chemin de Shur, Agar rencontre l’ange du Seigneur (Gn 16,7). Le terme hébreu mal’akh peut signifier « messager » ou « ange », mais son utilisation ici, associée au nom de Dieu que Hagar donnera plus tard, suggère une rencontre divine directe, unique pour une femme esclave non israélite. L’ange s’adresse à Agar avec compassion et lui demande : » Agar, esclave de Saraï, d’où viens-tu et où vas-tu ? » (Gn 16, 8). La formulation hébraïque est à la fois tendre et pénétrante, reconnaissant l’identité d’Agar tout en l’invitant à articuler son histoire – un rare moment d’action pour une femme marginalisée.
L’ange demande à Agar de retourner auprès de Saraï et de se soumettre à son autorité, en utilisant le verbe hébreu hit’anni (הִתְעַנִּי, » humilie-toi « ), qui fait écho à l’affliction antérieure de Saraï mais la recadre comme un acte d’endurance dans un but précis (Gn 16, 9). La promesse de l’ange selon laquelle les descendants d’Agar seraient multipliés au-delà de tout dénombrement(lo’ yisaper mi-rov, לֹא יִסָּפֵר מֵרֹב, « trop nombreux pour être comptés ») reflète le langage de l’alliance donné à Abram, élevant le rôle d’Agar dans le plan de Dieu (Gn 16 :10). Son fils, nommé Ismaël(Yishma’el, יִשְׁמָעֵאל), qui signifie « Dieu entend », dérive de la racine hébraïque shama’ (שָׁמַע), soulignant l’attention de Dieu à ses cris.
Ismaël deviendra par la suite le père des plus proches parents d’Israël, les Arabes. Les juifs et les chrétiens pensent souvent qu’il est devenu le père de tous les musulmans, mais ce n’est pas le cas. Seuls les Arabes (une minorité parmi les musulmans) remontent jusqu’à lui. Par ailleurs, le nom d’Ismaël a été utilisé dans les communautés juives, en particulier parmi les Juifs orientaux d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Des documents historiques tels que les registres des synagogues et les pierres tombales témoignent de son utilisation. Sa prévalence était plus élevée dans les communautés séfarades en raison du chevauchement culturel avec les régions arabophones, où Ismail est courant. Prenons l’exemple du rabbin Ishmael ben Elisha, qui a vécu de 90 à 135 de notre ère.
La réponse d’Agar aux paroles de l’ange est profonde. Elle nomme le Seigneur qui lui a parlé El Roi (אֵל רֹאִי), ce qui signifie « le Dieu qui me voit », un nom unique dans l’Écriture (Gn 16,13). Le verbe hébreu ra’ah (רָאָה, « voir ») a le sens d’une perception intime, suggérant que Dieu n’a pas seulement observé le sort d’Agar, mais qu’il l’a vraiment comprise. Ce moment souligne un thème central : L’attention de Dieu pour les marginaux, tissée dans le texte hébreu qui met l’accent sur le fait de voir et d’entendre.
La naissance d’Ismaël et d’Isaac
Agar retourne chez Abram et donne naissance à Ismaël alors qu’Abram a 86 ans (Gn 16,15-16). Saraï, qui s’appelle maintenant Sarah, a miraculeusement conçu et donné naissance à Isaac dans sa vieillesse, un nom lié à la racine hébraïque tzachaq (צָחַק, » rire « ) (Gn 21, 1-5 ; 25, 9). La naissance d’Isaac a accompli l’alliance de Dieu, l’établissant comme l’héritier par lequel les promesses de Dieu se réaliseraient.
Cependant, la naissance d’Isaac a ravivé les tensions. Lorsque Sarah voit Ismaël metzacheq (מְצַחֵק, « rire » ou « se moquer ») avec Isaac, le verbe hébreu suggère un acte ludique mais peut-être provocateur (certains ont suggéré un attouchement, bien que cela soit peu probable, puisque les frères sont vus à la fin de l’histoire pleurant leur père ensemble) (Gn 21,9). La demande de Sarah d’expulser Agar et Ismaël utilise le verbe dur garash (גָּרַשׁ, » divorcer/éloigner « ), reflétant sa détermination à assurer la prééminence d’Isaac (Gn 21, 10). Abraham est profondément troublé par la demande de Sarah. Le texte hébreu souligne la détresse d’Abraham avec ra’a be’eynav (רָעָה בְּעֵינָיו, « c’était mal à ses yeux »), soulignant son amour profond pour Ismaël, son fils premier-né(ben, בֵּן), terme chargé de poids émotionnel (Gn 21 :11). Dieu a rassuré Abraham en lui promettant qu’il prendrait soin d’Ismaël et qu’il deviendrait lui aussi un goy gadol (גּוֹי גָּדוֹל, « grande nation »), reprenant étonnamment le langage de l’alliance pour la postérité d’Isaac (Gn 21, 12-13).
Dans la tradition islamique, le Coran donne une nouvelle image de cette histoire, plaçant par erreur Abraham et Ismaël à La Mecque, l’Arabie saoudite moderne, en train de construire la Ka’ba (la maison de Dieu). Bien que cela contraste avec la Beersheba biblique (le Coran est connu pour sa pléthore d’inexactitudes lorsqu’il s’agit de réutiliser et de réorganiser des récits bibliques), cela invite à réfléchir sur le lien durable entre Abraham et Ismaël. La Genèse 25:9, qui décrit Ismaël et Isaac enterrant ensemble Abraham à sa mort, corrobore en partie l’idée de la continuité de la relation entre Abraham et Ismaël. Genèse 25 implique qu’un certain niveau de relation, sinon étroit, a persisté, car Ismaël était au courant de l’enterrement de son père à Hébron et y a participé. Après tout, il n’était pas si loin (c’est-à-dire à Beersheba, et non à la Mecque).
Deuxième rencontre divine
La confiance d’Abraham dans le Seigneur a été mise à l’épreuve sept fois dans le livre de la Genèse. La sixième épreuve, qui oblige Abraham à exiler Ismaël, préfigure la septième, dans la Genèse 22, où Dieu ordonne à Abraham de sacrifier Isaac. En fin de compte, Abraham a dû sacrifier ses deux fils pour devenir le père spirituel de tous les croyants. Abraham a renvoyé Agar et Ismaël avec des provisions minimales, en faisant confiance à Dieu pour leur avenir (Gn 21, 14). Dans le désert de Beersheba, alors que l’eau vient à manquer, le désespoir d’Agar se manifeste par le fait qu’elle élève la voix dans une démonstration de chagrin brut » (Gn 21, 16).
La réponse de Dieu est venue par l’intermédiaire de l’Ange du Seigneur, appelant du ciel et affirmant que Dieu shama’ (שָׁמַע, « a entendu ») les cris d’Ismaël (Gn 21, 17). Ismaël est devenu un chasseur expérimenté et prospère dans le désert de Paran, et Agar lui a procuré une épouse égyptienne (Gn 21, 20-21).
Conclusion
Dans l’histoire déchirante d’Agar, d’Abraham et de Sarah, le texte hébreu dévoile un Dieu qui transforme la rupture humaine en promesse divine. Agar, une esclave marginalisée, a trouvé l’espoir dans le désert, vue et entendue par le Dieu d’Abraham. L’histoire tisse une tapisserie de l’attention divine, affirmant que personne n’est invisible pour Dieu. L’obéissance angoissée d’Abraham et la frêle humanité de Sarah révèlent que même dans nos luttes les plus profondes, l’alliance et le dessein de Dieu perdurent, accomplissant ses desseins rédempteurs. Cette histoire nous rappelle qu’avec notre Dieu, aucune douleur ne passe inaperçue et aucun cri n’est ignoré. Comme Agar, nous sommes appelés à nous relever et à aider les autres à se relever du désespoir – à faire confiance à Dieu, qui nous ouvre les yeux sur des puits que nous ne voyons peut-être pas. Le Dieu d’Agar et d’Abraham nous voit, nous entend et tisse nos histoires fracturées dans sa tapisserie éternelle d’espoir, où chaque vie trouve un but et chaque larme, une rédemption.