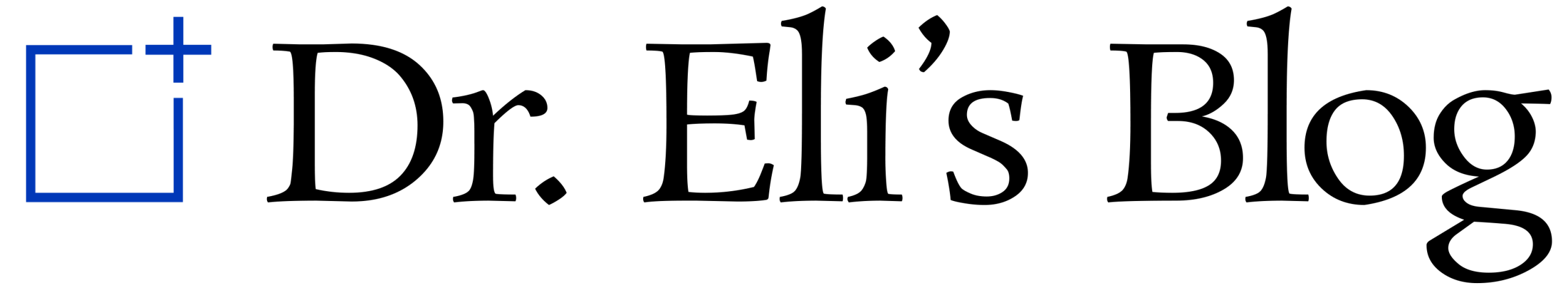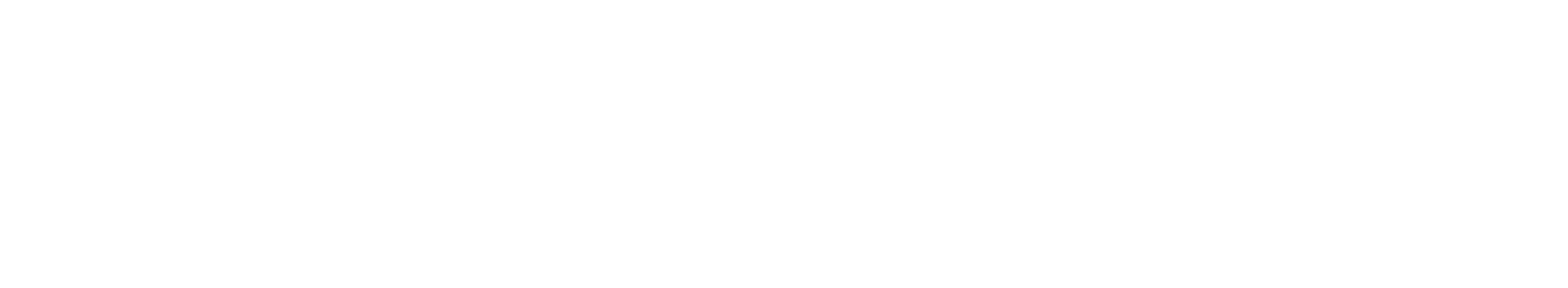L’une des questions les plus pressantes pour ceux qui s’intéressent de près à la Bible concerne le sixième des dix commandements, souvent compris comme une interdiction de « tuer » À première vue, ce commandement semble interdire catégoriquement de prendre la vie humaine, ce qui soulève des questions éthiques complexes sur des scénarios tels que l’autodéfense, la guerre ou la peine capitale. Cependant, un examen plus approfondi du texte hébreu révèle une directive plus nuancée, qui fait la distinction entre tuer et assassiner. En explorant les dimensions linguistiques, culturelles et théologiques de ce commandement, nous découvrons une compréhension plus riche qui remet en question les interprétations simplistes et invite à une réflexion plus large sur la justice, la moralité et l’intention divine dans la Bible hébraïque.
La traduction anglaise traditionnelle du sixième commandement, en particulier dans l’influente version King James, est « Tu ne tueras pas » (Exode 20:13 ; cf. Deutéronome 5:17). Cette traduction, reprise dans de nombreuses versions modernes (par exemple ASV, ESV, NRSV), suggère une interdiction générale de toutes les formes d’homicide. Cependant, le verbe hébreu qui sous-tend cette traduction -לרצח (ratsach) – a un sens plus spécifique que le terme anglais « kill » (tuer) Une traduction plus précise est « Tu ne commettras pas de meurtre », une interprétation adoptée par des traductions telles que la NIV, la CSB et la NJPS. Cette distinction est essentielle : si tout meurtre est une forme de meurtre, tout meurtre ne constitue pas un meurtre. Le meurtre, en termes bibliques, est la suppression injustifiée et intentionnelle d’une vie humaine, alors que d’autres formes de meurtre peuvent être permises ou même exigées dans certaines conditions.
Pour apprécier cette nuance, nous devons examiner les verbes hébreux associés à l’enlèvement de la vie. Le verbe להרוג (harag), qui signifie « tuer », est un terme général qui peut englober à la fois l’homicide justifié et injustifié. Par exemple, il est utilisé pour décrire l’assassinat d’Abel par Caïn (Genèse 4:8), un acte de meurtre, mais aussi le meurtre d’ennemis au combat (par exemple, 1 Samuel 17:50, où David « tue » Goliath). En revanche, le verbe רצח (ratsach), utilisé dans le sixième commandement, désigne spécifiquement le meurtre illicite. Ce verbe apparaît dans des contextes tels que Nombres 35:16-21, qui décrit l’homicide intentionnel avec malice, comme le fait de frapper quelqu’un avec une arme pour le tuer. Il est à noter que ratsach n’est jamais utilisé pour les meurtres justifiés, tels que la légitime défense, la guerre ou les exécutions ordonnées par un tribunal.
Un troisième verbe, להמית (hamit), qui signifie « mettre à mort », clarifie encore le vocabulaire biblique. Ce terme est souvent associé à des mises à mort sanctionnées par la loi ou ordonnées par Dieu, telles que la peine capitale (par exemple, Lévitique 20:10, où les adultères sont « mis à mort ») ou l’ordre de Dieu d’exécuter certains délinquants (par exemple, Deutéronome 13:9). La distinction entre ces verbes – harag (meurtre général), ratsach (meurtre) et hamit (exécution) – met en évidence la précision de la langue hébraïque dans le traitement des questions éthiques relatives à l’homicide. L’utilisation de ratsach dans le sixième commandement indique une interdiction du meurtre, et non une interdiction universelle de tout meurtre.
Cette précision linguistique modifie notre compréhension de la portée du commandement. La Torah elle-même fournit des exemples où il est permis ou nécessaire de tuer, soulignant ainsi que l’interdiction n’est pas absolue. Par exemple, Exode 22:2 stipule que si un voleur est tué alors qu’il s’introduit dans une maison la nuit, le défenseur n’est pas coupable, ce qui implique un droit à l’autodéfense. De même, Nombres 35:27 autorise le « vengeur du sang » à tuer un meurtrier qui s’enfuit d’une ville de refuge, ce qui constitue une forme de justice rétributive. La Torah impose également la peine capitale pour des délits tels que le meurtre (Genèse 9:6 ; Nombres 35:31), l’idolâtrie (Deutéronome 17:2-7) et la violation du sabbat (Exode 31:14). Dans la guerre, Dieu ordonne à Israël de détruire certaines nations, comme les Cananéens (Deutéronome 20:16-17), en utilisant des verbes comme harag ou hamit, jamais ratsach. Ces exemples montrent que le sixième commandement vise l’homicide injustifié et malveillant, et non tous les actes de mise à mort.
Le contexte culturel et juridique du Proche-Orient ancien éclaire encore cette distinction. Dans les codes juridiques mésopotamiens et hittites, tels que le code d’Hammourabi, des distinctions étaient faites entre l’homicide intentionnel et l’homicide involontaire, les peines variant en fonction de l’intention et des circonstances. L’accent mis par la Torah sur le ratsach s’aligne sur cette tradition juridique plus large, en se concentrant sur les actes de violence prémédités ou commis par négligence qui perturbent l’harmonie de la communauté. Nombres 35:22-25, par exemple, fait la différence entre le meurtre intentionnel (ratsach) et l’homicide involontaire, prescrivant la mort pour le premier et la protection dans une ville de refuge pour le second. Ce cadre reflète une compréhension sophistiquée de la justice, équilibrant le châtiment et la miséricorde et reconnaissant la complexité des actions humaines.
D’un point de vue théologique, le sixième commandement souligne le caractère sacré de la vie humaine, enraciné dans la croyance que les êtres humains sont créés à l’image de Dieu (Genèse 1:26-27). Le meurtre, en tant qu’acte de ratsach, viole cette empreinte divine, usurpant l’autorité de Dieu sur la vie et la mort. Cependant, l’autorisation de certains meurtres – tels que l’exécution ou la guerre – suggère que Dieu délègue son autorité à des agents humains dans des conditions spécifiques, en particulier pour faire respecter la justice ou protéger la communauté de l’alliance. Cette délégation est évidente dans Genèse 9:6, qui déclare : « Quiconque verse le sang de l’homme, c’est par l’homme que son sang sera versé », affirmant le principe de la justice rétributive tout en utilisant le verbe shafach (« verser ») plutôt que ratsach, ce qui indique un contexte plus large pour les meurtres justifiés.
En élargissant la discussion, le sixième commandement invite à réfléchir aux tensions éthiques entre la justice et la miséricorde dans la Bible hébraïque. Alors que Dieu interdit le meurtre, les dispositions légales de la Torah révèlent une approche pragmatique de l’imperfection humaine. Les villes de refuge (Nombres 35, 9-15) protègent les meurtriers involontaires, faisant preuve de miséricorde, tandis que la peine de mort pour les meurtriers confirme la justice. Cet équilibre reflète la reconnaissance divine de la complexité humaine, où l’intention, le contexte et les conséquences façonnent les jugements moraux. Le commandement incite également à examiner comment les principes bibliques s’appliquent aux dilemmes éthiques modernes, tels que la peine capitale, l’avortement ou la guerre. Si la Torah autorise certains meurtres, l’accent qu’elle met sur le caractère sacré de la vie nous incite à aborder ces questions avec humilité et discernement, en veillant à ce que toute atteinte à la vie soit conforme à la justice et à la volonté divine.
La distinction entre meurtre et assassinat trouve également un écho dans la littérature de sagesse au sens large. Par exemple, Proverbes 6:16-17 énumère « les mains qui versent le sang innocent » parmi les choses que Dieu déteste, en utilisant le verbe shafach mais en impliquant le type de meurtre injustifié qui s’apparente à ratsach. De même, les Psaumes déplorent la violence injuste (par exemple, Psaume 94:6), renforçant la condamnation biblique du meurtre en tant que perturbation de l’ordre de Dieu. Ces textes suggèrent que le sixième commandement n’est pas une règle isolée, mais qu’il fait partie d’un cadre éthique plus large qui valorise la vie tout en reconnaissant la nécessité de la justice.
Pour les lecteurs contemporains, la compréhension du verbe hébreu ratsach transforme le sixième commandement d’une interdiction simpliste en un appel profond à honorer le caractère sacré de la vie. Elle nous incite à faire la distinction entre les actes malveillants et ceux motivés par la nécessité ou la justice, encourageant ainsi une approche nuancée de la prise de décision éthique. Cette perspective invite également au dialogue avec d’autres thèmes bibliques, tels que le pardon et la réconciliation, qui tempèrent la justice par la compassion. Par exemple, l’histoire de David épargnant la vie de Saül (1 Samuel 24) illustre le refus de commettre des crimes, même lorsque le meurtre semble justifié, soulignant ainsi la valeur de la miséricorde par rapport à la vengeance.
En conclusion, le sixième commandement, enraciné dans le verbe hébreu רצח (ratsach), interdit le meurtre – l’homicide injustifié et intentionnel – plutôt que toutes les formes de meurtre. L’utilisation par la Torah de verbes distincts tels que harag et hamit, parallèlement aux dispositions légales relatives à la légitime défense, à l’exécution et à la guerre, révèle un cadre éthique nuancé qui établit un équilibre entre le caractère sacré de la vie et les exigences de la justice. Cette compréhension, fondée sur le contexte linguistique et culturel de la Bible hébraïque, met les lecteurs modernes au défi de dépasser les interprétations trop simples et de s’engager dans les complexités de la morale biblique. En reconnaissant que Dieu interdit le meurtre mais autorise certains meurtres dans des conditions exceptionnelles, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont ces principes éclairent notre approche de la justice, de la miséricorde et de la valeur de la vie humaine dans le monde d’aujourd’hui.