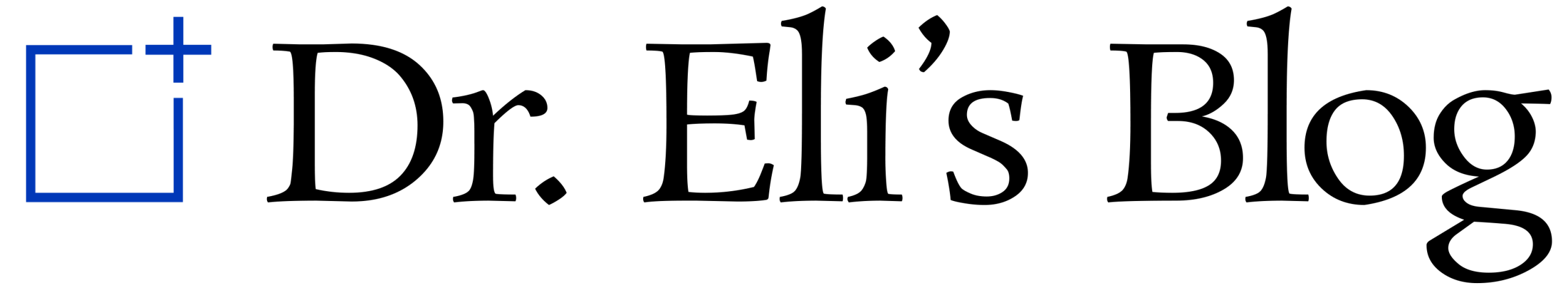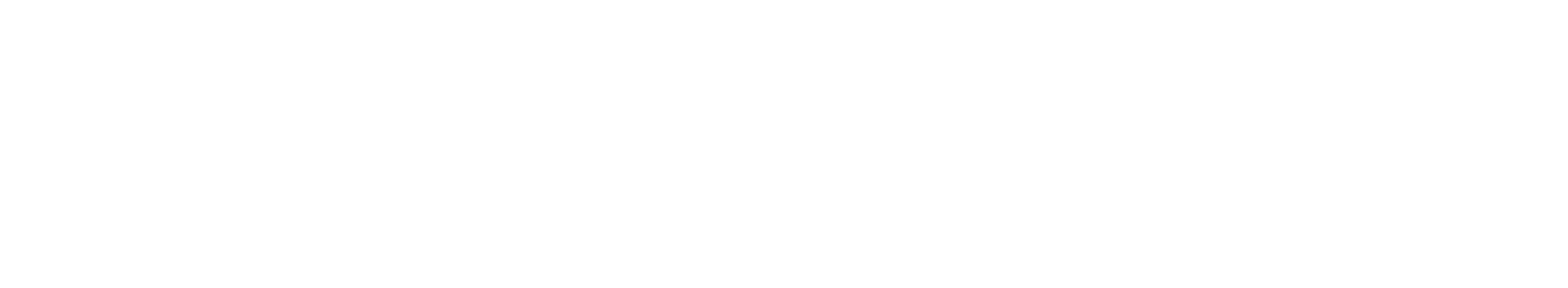J’aimerais vous faire part d’une anecdote humoristique que j’ai trouvée, racontée à l’origine par un humoriste juif russe, Gary Guberman. La blague se déroule sous la forme d’une conversation entre deux amis âgés, Abram et Chaim. Abram, qui a 87 ans, décide de rendre visite à son ami plus âgé, Chaim, qui a 97 ans.
Abram : « Chaim, je suis venu te dire au revoir parce que demain je quitterai cette vie. J’ai vécu une vie longue et heureuse, mais maintenant je suis prêt à partir, et c’est sûr que cela arrivera demain. »
Surpris par la certitude de son jeune ami, Chaim lui fait une demande particulière.
Chaim : « Abram, j’ai une faveur à te demander. »
Abram : « Oui, Chaim. N’importe quoi. »
Chaim : « Demain, quand tu partiras, tu iras dans un endroit meilleur et à un moment donné, tu rencontreras peut-être le Créateur, béni soit-il. Il est possible qu’il te pose des questions à mon sujet. Alors, s’il te plaît, dis-lui que tu ne m’as pas vu depuis un moment et que tu n’as aucune idée de l’endroit où je me trouve ».
Cet échange léger nous invite à réfléchir à une question sérieuse : quel est l’état de ceux qui ont quitté cette vie, et peuvent-ils interagir avec ceux qui sont encore sur terre ? Pour les chrétiens, cette question est au cœur de la doctrine de la communion des saints, selon laquelle les croyants, qu’ils soient sur terre ou au ciel, restent unis en Christ et peuvent se soutenir mutuellement par la prière. Cet article explore les fondements bibliques, historiques et théologiques de la demande faite aux défunts, y compris à Marie, la Mère de Jésus, d’intercéder pour nous. Il répond également aux objections courantes des protestants et s’inspire des traditions juives pour donner un contexte plus large à cette pratique, chère aux catholiques, aux orthodoxes et à certains chrétiens anglicans et luthériens.
Pour comprendre l’état des défunts, il faut d’abord se référer à l’enseignement de Jésus dans Matthieu 22:29-32. Lorsque les sadducéens, qui niaient la résurrection, ont posé à Jésus une question hypothétique sur le mariage dans l’au-delà, il a répondu : « Vous êtes dans l’erreur, car vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu… En ce qui concerne la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit : ‘Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob’ ? Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » En citant Exode 3:15, Jésus affirme qu’Abraham, Isaac et Jacob, bien que physiquement décédés, sont vivants dans la présence de Dieu. Ce passage établit une prémisse théologique essentielle : ceux qui sont morts dans la foi ne sont pas vraiment morts, mais vivent en communion avec Dieu. Cette compréhension constitue la base de la doctrine de la communion des saints, exprimée dans le Credo des Apôtres, qui déclare croire en « la sainte Église universelle, la communion des saints » Historiquement, cette expression englobait à la fois les croyants vivants et ceux qui sont au ciel, suggérant une unité mystique qui transcende la mort physique.
Le livre des Hébreux éclaire encore cette idée en décrivant une « grande nuée de témoins » entourant les croyants (Hébreux 12:1). Cette image évoque les fidèles des générations passées – des personnages comme Gédéon, David et les prophètes – qui, par la foi, ont conquis des royaumes, enduré des épreuves et sont maintenant témoins de la course continue de ceux qui sont sur terre (Hébreux 11:32-38). Ce passage implique que les défunts restent conscients et engagés dans les luttes des vivants. S’ils sont vivants dans la présence de Dieu et font partie de cette communion, est-il approprié de leur demander de prier pour nous, comme nous le ferions pour un ami sur terre ? Pour beaucoup de chrétiens, la réponse est oui. La logique est simple : si je peux demander à un coreligionnaire d’intercéder pour moi, pourquoi ne pas demander à quelqu’un au ciel, qui est plus proche de Dieu ? Cette pratique est particulièrement associée à Marie, vénérée comme la Mère de Jésus, dont le rôle unique fait d’elle une puissante intercesseuse dans les traditions catholique et orthodoxe.
L’Écriture donne un aperçu du rôle d’intercesseur des saints au ciel. Dans Apocalypse 6, 9-10, les âmes des martyrs s’écrient : « Jusques à quand, Seigneur, saint et vrai, t’abstiendras-tu de juger et de venger notre sang sur ceux qui vivent sur la terre ? Cette prière passionnée montre les défunts plaidant pour la justice au nom des vivants. De même, Apocalypse 5:8 et 8:3-4 dépeignent des êtres célestes présentant à Dieu les prières des saints, ce qui suggère que les défunts amplifient les requêtes terrestres. Ces passages soutiennent l’idée que les saints au ciel ne sont pas détachés mais participent activement au plan de rédemption de Dieu. Pour les chrétiens catholiques et orthodoxes, demander à Marie ou à d’autres saints de prier est une extension de cette réalité, un peu comme si l’on se joignait à une réunion de prière céleste où tous les croyants, vivants et défunts, s’unissent dans le Christ.
Les chrétiens protestants soulèvent souvent des objections à cette pratique, en citant Deutéronome 18:10-15, qui interdit de consulter les morts par des pratiques telles que la divination, la sorcellerie ou la médiumnité. Cette interdiction doit cependant être comprise dans son contexte. Le Deutéronome condamne les pratiques païennes visant à obtenir des connaissances cachées ou à manipuler les forces spirituelles, comme on le voit dans les rituels des nations environnantes. Il n’aborde pas la question de la demande de prière d’intercession. Jésus lui-même, qui a parfaitement accompli la Loi, a communiqué avec Moïse et Elie lors de la Transfiguration (Matthieu 17:3), ce qui indique que l’interaction avec les défunts n’est pas intrinsèquement un péché. La distinction essentielle réside dans l’objectif : une séance cherche à obtenir une connaissance interdite, tandis que demander la prière est un humble acte de fraternité. L’histoire de Saül et du médium dans 1 Samuel 28:8-15 illustre ce point. Le péché de Saül ne consistait pas simplement à contacter Samuel, mais à rechercher des informations stratégiques pour vaincre ses ennemis, poussé par la peur et l’impatience plutôt que par la confiance en Dieu. En revanche, demander la prière à Marie ou aux saints est conforme à la nature communautaire de la foi chrétienne, où les croyants se soutiennent les uns les autres au-delà du fossé de la mort.
Les traditions juives offrent un contexte précieux pour cette pratique. Dans le judaïsme rabbinique, la prière sur les tombes des justes (kivrei tzaddikim) est une coutume ancestrale. Le Talmud raconte que Caleb s’est rendu dans la grotte des Patriarches pour demander à ses ancêtres d’intercéder en sa faveur contre les mauvais conseils des espions (Sotah 34b). De même, Taanit 16a décrit des Juifs priant dans des cimetières lors de calamités, croyant que les défunts pouvaient demander la miséricorde en leur nom. Ces pratiques reflètent la croyance selon laquelle les justes, même après leur mort, restent en contact avec les vivants et peuvent renforcer leurs prières. La prière juive Machnisei Rachamim demande aux anges de porter les supplications humaines à Dieu, parallèlement aux demandes chrétiennes adressées aux saints. Un exemple frappant apparaît dans Jérémie 31:15, où Rachel, décédée depuis longtemps, pleure les exilés d’Israël, et Dieu l’entend. Bien que possiblement poétique, ce texte suggère que les justes décédés s’occupent des vivants et intercèdent pour eux, une croyance que les premiers chrétiens ont probablement héritée et adaptée.
Une autre objection protestante est que l’Écriture manque d’un enseignement explicite sur la demande de prières aux défunts. Bien qu’il n’existe pas de commandement direct, cette absence n’équivaut pas à une interdiction. De nombreuses doctrines chrétiennes, comme celle de la Trinité, ne sont pas explicitement énoncées dans les Écritures, mais sont nées d’une réflexion théologique sur des vérités implicites. L’abolition de l’esclavage et la préférence pour la monogamie n’ont pas non plus de mandat biblique explicite, mais sont universellement acceptées par les chrétiens d’aujourd’hui, et se sont développées à travers des trajectoires dans les Écritures. Les livres des Maccabées, qui font partie des canons catholiques et orthodoxes, apportent un soutien supplémentaire. Dans 2 Maccabées 15, 12-15, Juda Maccabée a une vision de Jérémie priant pour Israël, ce qui souligne son rôle d’intercesseur. Les critiques qui affirment que cette pratique n’est pas biblique signifient souvent qu’elle est absente du canon protestant, qui exclut ces livres. Cependant, ces textes faisaient partie du canon chrétien primitif, inclus dans la Septante et confirmés par des conciles comme ceux de Rome (382) et de Trente (1546). Les premières Bibles protestantes, y compris la traduction de Luther et la version King James de 1611, contenaient ces livres, souvent en tant que lecture « utile », jusqu’à ce qu’ils soient supprimés en 1825 par la British Foreign Bible Society.
La parabole de Lazare et de l’homme riche (Luc 16:19-31) apporte un éclairage supplémentaire. Dans cette histoire, l’homme riche, qui se trouve dans le séjour des morts, demande à Abraham d’envoyer Lazare pour l’aider ou avertir ses frères. Si la leçon principale de la parabole met l’accent sur la suffisance de la parole de Dieu (Moïse et les prophètes), elle reflète un présupposé culturel juif selon lequel il est possible d’adresser une requête aux défunts. Cela suggère que l’auditoire de Jésus était familier avec de telles idées, même si la parabole n’approuve pas franchement cette pratique. Si l’on ajoute à cela les descriptions de l’Apocalypse concernant la prière des saints et les traditions juives, on obtient un argument solide en faveur de la légitimité de demander aux défunts, y compris à Marie, d’intercéder.
Une dernière objection concerne le rôle du Christ en tant qu’unique médiateur (1 Timothée 2:5). Cependant, la prière d’intercession ne remet pas en cause ce rôle. Dans 1 Timothée 2:1-4, Paul exhorte les croyants à prier les uns pour les autres, qualifiant cette prière de « bonne et agréable » à Dieu. Si l’intercession terrestre est valable, l’intercession céleste l’est aussi, car toutes deux reposent sur la médiation du Christ. Demander à Marie ou aux saints de prier, ce n’est pas contourner Jésus, mais se joindre à eux pour rechercher sa grâce. Le rôle unique de Marie en tant que mère de Jésus fait d’elle une intercesseur particulièrement puissant, vénéré dans les traditions qui la voient comme une nouvelle Rachel, pleurant et priant pour le peuple de Dieu.
En conclusion, la pratique consistant à demander à Marie et aux saints de prier pour nous peut être considérée comme fondée sur l’affirmation biblique selon laquelle les défunts sont vivants en Dieu et prient activement en tant que membres de la communion des saints. Les traditions juives, les premiers credo chrétiens et les aperçus scripturaires de l’intercession céleste soutiennent ce point de vue. Les objections fondées sur le Deutéronome, l’absence d’enseignement explicite ou la médiation du Christ sont traitées en faisant la distinction entre les pratiques occultes et les demandes de prière, en reconnaissant les trajectoires bibliques implicites et en affirmant le rôle unique du Christ. À l’instar de l’échange ludique entre Abram et Chaim, la communion des saints nous invite à considérer les défunts comme des partenaires de prière, unis dans l’amour du Christ.