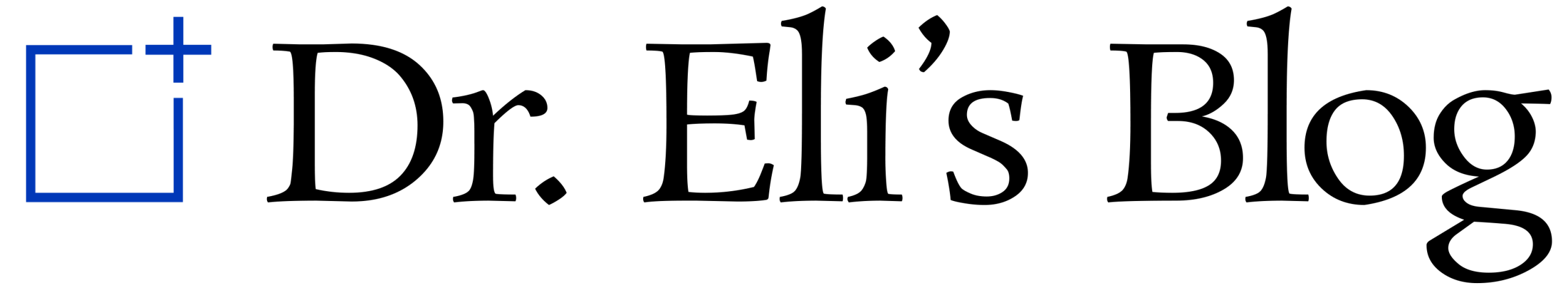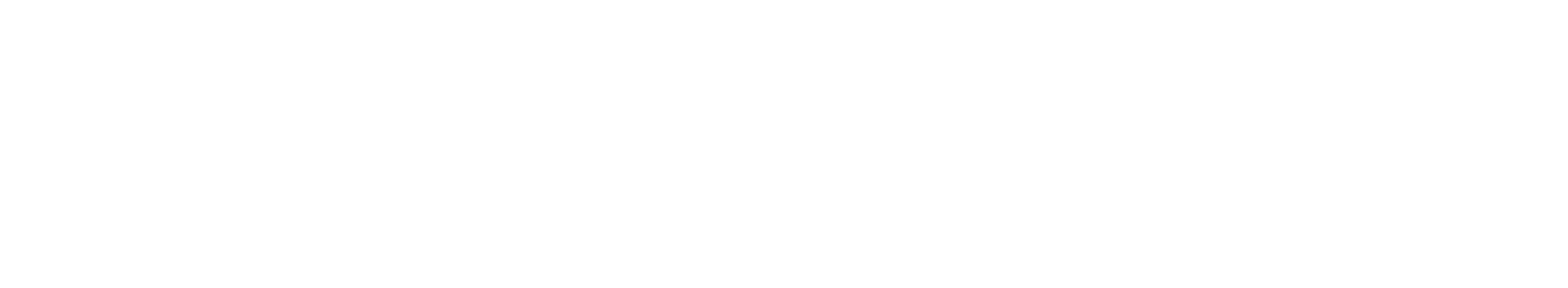L’Évangile de Luc tisse de manière complexe les histoires de Marie, d’Élisabeth et de leurs homologues de l’Ancien Testament, en particulier Sarah, afin de mettre en évidence la fidélité de Dieu à son alliance avec Israël. Le récit d’Élisabeth et de Zacharie dans Luc 1 reflète l’histoire d’Abraham et de Sarah, en mettant l’accent sur les thèmes de la justice, de la conception miraculeuse et de l’accomplissement de la promesse divine. Cet article explore ces parallèles, en se concentrant sur la manière dont l’histoire d’Elisabeth renforce l’identité juive de Marie et le contexte juif plus large de l’évangile de Luc.
Luc 1,5-7 présente Élisabeth et Zacharie comme des Juifs justes, « marchant sans reproche dans tous les commandements et toutes les prescriptions du Seigneur » Cette description fait écho à celle d’Abraham et de Sarah, qui étaient également justes devant Dieu (Genèse 15:6). Comme Sarah, Élisabeth est confrontée au stigmate de l’infertilité, un défi de taille dans une culture où la procréation était un signe de bénédiction divine (Genèse 16:2). L’âge avancé des deux couples – Abraham et Sarah dans Genèse 17:17 et Elisabeth et Zacharie dans Luc 1:7 – prépare le terrain pour l’intervention miraculeuse de Dieu, un motif récurrent dans les écritures juives où Dieu surmonte les limites humaines pour accomplir ses promesses.
L’apparition de l’ange Gabriel à Zacharie dans le Temple (Luc 1, 8-20) est parallèle aux annonces divines faites à Abraham et Sarah (Genèse 18, 1-15). Zacharie et Sarah expriment d’abord leur incrédulité face à la promesse d’un enfant en raison de leur âge (Luc 1,18 ; Genèse 18,12), mais Dieu reste fidèle. Le mutisme temporaire de Zacharie (Luc 1:20) sert de signe de discipline divine, tout comme le rire initial de Sarah, mais les deux histoires culminent avec la naissance des enfants promis – Isaac et Jean – qui jouent un rôle central dans le plan de Dieu. Ces parallèles soulignent la continuité de la fidélité de l’alliance de Dieu à travers les générations, un thème central de la théologie juive.
L’histoire d’Élisabeth sert de pont à celle de Marie, renforçant le contexte juif de leurs expériences communes. Dans Luc 1,36, Gabriel informe Marie de la grossesse d’Elisabeth, la présentant comme la preuve que « rien n’est impossible à Dieu » Ce lien entraîne Marie dans le même arc narratif que Sarah et Élisabeth, où l’intervention divine surmonte l’impossibilité humaine. L’isolement d’Élisabeth pendant cinq mois (Luc 1,24) fait écho à la grossesse cachée de Sarah (Genèse 21,2), soulignant le caractère sacré de l’œuvre de Dieu dans leur vie. Lorsque Marie rend visite à Elisabeth, la salutation prophétique de cette dernière (Luc 1,41-45) confirme le rôle de Marie en tant que mère du Messie, reliant leurs histoires à l’espoir juif plus large de la rédemption.
Le caractère juif de l’histoire d’Elisabeth est évident dans le cadre du Temple et dans le contexte sacerdotal. Zacharie, prêtre de la division d’Abijah, exerce ses fonctions dans le Temple de Jérusalem, institution centrale de la vie juive (Luc 1,8-10). La description détaillée des pratiques du Temple, telles que la combustion de l’encens, suggère que Luc a une connaissance intime du rituel juif, ce qui remet en question l’hypothèse selon laquelle il serait un auteur païen. Elisabeth, en tant que fille d’Aaron (Luc 1,5), incarne la lignée sacerdotale, la reliant au sacerdoce de l’alliance établi dans Exode 28. Sa droiture et son adhésion à la Torah la rapprochent des femmes fidèles d’Israël, comme Anne, dont la prière pour un enfant (1 Samuel 1,11) préfigure l’expérience d’Élisabeth.
Les parallèles entre Élisabeth et Sarah s’étendent à leurs rôles de mères de précurseurs. Isaac, né de Sarah, devient l’héritier de l’alliance abrahamique, par lequel s’accomplissent les promesses de Dieu à Israël (Genèse 21,12). De même, Jean, né d’Élisabeth, est le précurseur du Messie, préparant la voie à Jésus dans l’esprit d’Élie (Luc 1:17 ; Malachie 4:5-6). Les deux femmes, par leurs conceptions miraculeuses, participent au plan de rédemption de Dieu, incarnant l’espoir juif d’une restauration divine.
L’interaction entre Marie et Élisabeth met encore plus en évidence ces parallèles. La reconnaissance par Élisabeth de Marie comme « bénie entre les femmes » (Luc 1,42) fait écho à l’honneur accordé à Sarah en tant que mère des nations (Genèse 17,16). Le nom d’Élisabeth (Elisheva en hébreu, qui signifie « Mon Dieu est fidèle ») la relie à l’Elisheva de l’Ancien Testament, épouse d’Aaron (Exode 6:23), renforçant ainsi son héritage sacerdotal. De même, le nom de Marie (Miriam en hébreu) la relie à la sœur de Moïse, une prophétesse qui conduisait Israël dans l’adoration (Exode 15:20-21). Ces noms communs soulignent la continuité de la foi entre l’Ancien et le Nouveau Testament, Marie et Élisabeth incarnant la même confiance dans les promesses de Dieu que leurs prédécesseurs.
Le Magnificat (Luc 1, 46-55) rattache encore davantage Marie à la tradition juive des femmes fidèles comme Sarah et Anne. Ses parallèles avec la prière d’Anne (1 Samuel 2, 1-10) soulignent la justice de Dieu dans le renversement des fortunes humaines – en élevant les humbles et en humiliant les orgueilleux. La déclaration de Marie selon laquelle « toutes les générations me diront bienheureuse » (Luc 1,48) reflète la conscience qu’elle a de son rôle dans l’histoire de l’alliance d’Israël, à l’instar de l’héritage de Sarah en tant que mère du peuple élu de Dieu. Cette prière situe Marie dans la tradition prophétique juive, où des femmes comme Déborah et Miriam ont exprimé les louanges de Dieu (Juges 5,1-31 ; Exode 15,21).
Le cadre juif de ces événements est crucial. Nazareth et Bethléem, où se déroulent les histoires de Marie et d’Elisabeth, sont imprégnées de l’espoir messianique juif. Nazareth tire peut-être son nom de l’hébreu « netzer » (branche), titre messianique d’Isaïe 11,1, tandis que Bethléem est la ville de David, liée au royaume éternel promis (2 Samuel 7,16). La crèche, humble mangeoire, est liée au nom de Bethléem (« Maison du pain ») et préfigure le rôle de Jésus en tant que nourriture spirituelle, enraciné dans l’imagerie de la Pâque juive.
Le rôle prophétique d’Elisabeth, qui reconnaît l’appel divin de Marie (Luc 1,41-45), reflète la foi de Sarah dans la promesse de Dieu, en dépit de ses doutes initiaux. Les deux femmes, par leurs grossesses miraculeuses, témoignent du pouvoir de Dieu d’accomplir sa parole. Leurs histoires se rejoignent en Marie, dont la naissance virginale accomplit la promesse ultime d’un Messie. Le récit de Luc présente donc Élisabeth et Marie comme les héritières de Sarah, incarnant la foi juive qui se fie aux promesses de l’alliance de Dieu.