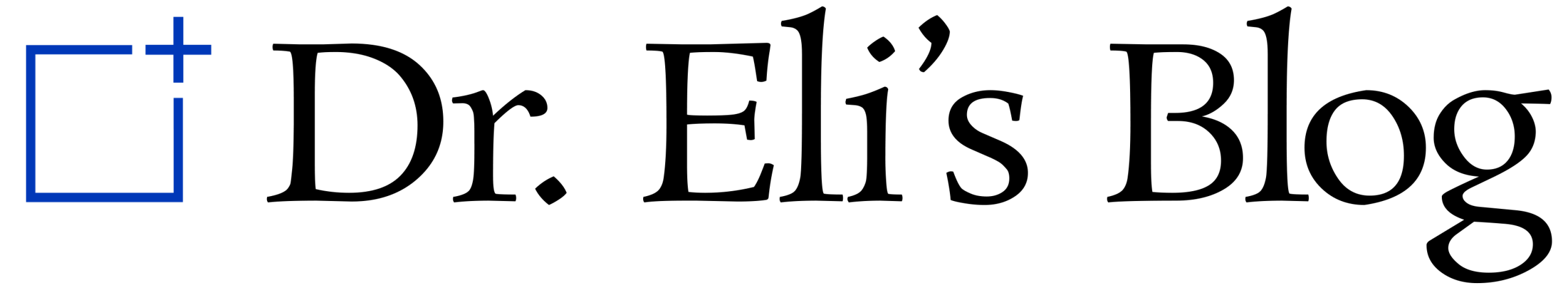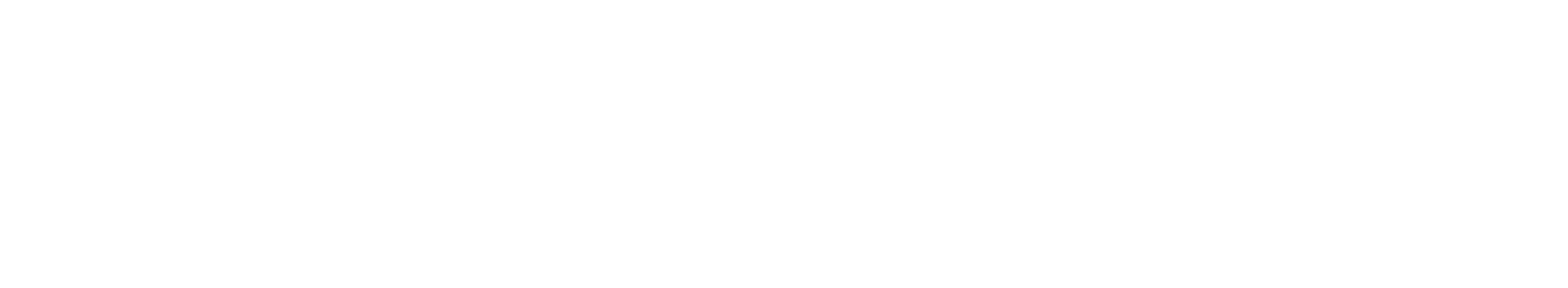Les épisodes de l’épouse et de la sœur se déroulent comme trois histoires distinctes, chacune marquée par la peur et la tromperie dans un pays étranger. En Gn 12, 10-20, une famine pousse Abram (futur Abraham) et Saraï (future Sarah) en Égypte. Craignant que la beauté de Saraï n’incite les hommes de Pharaon à le tuer, Abram lui demande de se faire passer pour sa sœur. Pharaon, ignorant leur mariage, prend Saraï dans son harem et récompense Abram en lui offrant du bétail et des serviteurs. Dieu intervient avec des fléaux, révélant le véritable statut de femme mariée de Saraï, et Pharaon, furieux, expulse le couple.
Dans Gn 20, 1-18, Abraham et Sarah, qui se trouvent maintenant à Gerar, une région philistine située entre l’actuelle bande de Gaza et la mer Morte, font l’expérience d’une sorte de déjà-vu. Le roi Abimélek s’empare de Sarah, mais cette fois, le Dieu d’Abraham avertit le roi dans un rêve, l’empêchant de coucher avec elle et invoquant sa colère. Abimélek rend Sarah, dédommage Abraham et Sarah par des cadeaux et les invite gracieusement à rester dans son royaume.
Enfin, dans Gn 26, 1-11, Isaac, confronté à la famine, s’installe à Guérar et prétend que Rebecca est sa sœur. Abimélek découvre la vérité lorsqu’il voit Isaac flirter avec Rebekah, le réprimande, mais assure leur sécurité. Ces épisodes révèlent un schéma récurrent : les patriarches, malgré leurs grands épisodes de foi, recourent à la tromperie par peur et se trompent souvent complètement de situation, mettant en péril l’honneur de leurs épouses et certainement l’honneur de leur Dieu. Pourtant, leur Dieu comprend, pardonne et les protège constamment, ainsi que tous ceux qui dépendent d’eux dans leurs caravanes. Le thème de leur salut reflète la délivrance des Israélites d’Égypte et leur errance dans le désert, mettant en évidence des événements continus d’intervention divine malgré un manque significatif de foi et d’obéissance parmi les anciens esclaves.
L’objectif de Moïse pour les Israélites
La Torah de Moïse a inclus ces récits pour inspirer et instruire les Israélites qui venaient d’échapper à des siècles d’esclavage en Égypte. Alors qu’ils erraient dans le désert, aux prises avec leur identité en tant que peuple choisi par Dieu, ces récits établissaient un lien entre leurs luttes et leurs nombreux échecs et ceux de leurs ancêtres. Les événements concernant Abraham et Isaac reflètent à bien des égards le séjour des Israélites en Égypte et leur sortie d’Égypte, où ils ont également subi l’oppression des rois locaux. Mais tout comme Dieu a protégé Saraï/Sarah par des fléaux en Égypte et un rêve divin à Guérar, il a déclenché des fléaux et des miracles pour libérer les Israélites de l’esclavage, les accompagnant miraculeusement dans leurs pérégrinations malgré leurs nombreux défauts (Exode 7-12).
Le voyage des Israélites dans le désert a été marqué par des échecs répétés liés à la foi et à la peur, notamment des plaintes concernant la nourriture et l’eau (Ex 16:2-3), l’adoration d’un veau d’or (Ex 32), le rejet de la Terre promise après le rapport effrayant des espions (Nb 13-14), et la rébellion contre la direction de Moïse par le soulèvement de Koré (Nb 16). Ils ont succombé à l’idolâtrie et à l’immoralité à Baal Peor (Nb 25), se sont plaints de la manne (Nb 11, 21) et se sont querellés à Meriba, où même Moïse a désobéi (Nb 20).
En soulignant la fidélité de Dieu malgré les défauts humains, Moïse a encouragé les Israélites à faire confiance aux promesses de l’alliance de Dieu, comme l’avaient fait leurs ancêtres, et à tirer des leçons des erreurs de ces derniers. Malgré ces échecs, Dieu est resté fidèle et a conduit les Israélites en toute sécurité jusqu’à la Terre promise, comme il l’avait promis. En d’autres termes, ces récits soulignent que le projet de Dieu de faire d’eux une grande nation (Gn 12,2) prévaudra, comme il l’a fait pour Abraham, Isaac et Jacob, en les guidant vers la Terre promise (Exode 19,4-6).
Le contexte culturel et historique de la tromperie
Les récits d’Abraham et d’Isaac dans la Genèse se déroulent à l’époque patriarcale, approximativement entre 2000 et 1800 avant notre ère, à l’âge du bronze moyen. À cette époque, les voyages étaient périlleux et très différents du tourisme moderne. Le vol et la violence étaient des risques courants pour les voyageurs (Gn 14,12-14). En tant que chefs semi-nomades, Abraham et Isaac conduisaient de grandes caravanes, semblables aux tabors (campements) bédouins ou tsiganes actuels, à la recherche de pâturages ou fuyant la famine. Ces déplacements faisaient d’eux à la fois des menaces et des alliés potentiels pour les dirigeants locaux, ce qui a profondément modifié leurs interactions.
Les harems et le rôle de Sarah
Dans le Proche-Orient ancien, les femmes étaient souvent considérées comme des biens, leur statut étant lié à la position sociale de leur mari. L’expression hébraïque de Genèse 20:3, décrivant Sarah comme « propriété d’un mari » (וְהִיא בְּעוּלַת בַּעַל, vehi be’ulat ba’al), souligne ce point de vue, la décrivant comme la possession d’Abraham. Pour les lecteurs modernes, cela est troublant, d’autant plus que le « grand péché » d’Abimélek (חָטָא גָדוֹל, chata gadol, Gn 20,9) consistait moins à violer la dignité de Sarah qu’à empiéter sur la propriété d’un autre homme. La Genèse présente ces histoires sans s’excuser, mettant au défi les publics anciens et modernes de se débattre avec leurs complexités morales.
À cette époque, les harems étaient plus que des collections d’épouses ; ils étaient des centres de pouvoir politique. Prendre une femme, en particulier par le biais du mariage, pouvait permettre de forger des alliances ou de renforcer l’influence d’un dirigeant. Dans Genèse 12:16, les cadeaux de Pharaon à Abraham – bétail et serviteurs – suggèrent un accord diplomatique, peut-être pour s’assurer l’allégeance d’un chef riche comme Abraham. Les rois locaux formaient souvent de telles alliances avec de nombreux chefs pour renforcer leur autorité. De même, l’intérêt d’Abimélek pour Sarah (Gn 20,2) mêle probablement une attirance personnelle à un désir de s’allier à la caravane prospère et militairement compétente d’Abraham.
L’âge de Sarah – environ 65 ans en Égypte et 90 ans à Guérar (Gn 17,17 ; Gn 23,1) – soulève des questions pour les lecteurs modernes. Deux explications permettent d’y voir plus clair. Tout d’abord, la Genèse suggère que l’espérance de vie à cette époque était très longue. Abraham a vécu jusqu’à 175 ans (Gn 25,7), Sarah jusqu’à 127 ans, et les généalogies de Gn 5 et 11 font état d’une longévité de plusieurs siècles. Cela implique un vieillissement plus lent, permettant à Sarah de rester attirante pour les souverains même à un âge avancé. L’âge des rois est inconnu. Il se peut qu’ils aient été âgés et qu’ils aient recherché des mariages stratégiques plutôt que des expériences de jeunesse. Deuxièmement, les harems servaient des objectifs politiques au-delà de l’attrait physique. Le statut de Sarah en tant que « sœur » d’Abraham et son lien avec sa richesse (Gn 13,2) en faisaient un atout précieux pour les alliances. Certains érudits soutiennent que l’affirmation d’Abraham selon laquelle Sarah était sa sœur reflétait une ancienne coutume hurrienne visant à élever le statut de l’épouse, et non une tromperie. Cependant, les réactions des rois suggèrent que l’intention d’Abraham était une tromperie protectrice, et non un honneur culturel.
La communauté mobile d’Abraham
La caravane d’Abraham était une communauté mobile, soulignant son importance. La Genèse 12:5 mentionne ses « possessions » et « les gens qu’ils avaient acquis », la Genèse 13:2 fait état de sa richesse et la Genèse 14:14 mentionne 318 « hommes nés dans sa maison et ayant reçu une formation militaire » On estime que son groupe comptait entre 800 et 1 500 personnes, avec 40 à 80 tentes, 100 à 300 animaux de transport et des milliers de têtes de bétail, qui s’étendaient sur plus d’un kilomètre au fur et à mesure de leur voyage.
Réflexion sur la foi et les actions d’Abraham
La Genèse 26 raconte la rencontre d’Isaac avec le fils d’Abimélek, le nouveau roi de Guérar, mais elle met aussi en lumière l’obéissance d’Abraham. Les paroles que Dieu adresse à Isaac sont frappantes :
« Je serai avec toi et je te bénirai, car c’est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays… parce qu’Abraham m’a obéi et qu’il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois » (Gn 26, 3-5).
Si faire passer Sarah pour sa sœur est un péché – souvent considéré comme un mensonge et un manque de foi -, comment Dieu peut-il louer Abraham de manière aussi élogieuse ? Plusieurs points clarifient cette tension.
La nature de la vérité dans les dix commandements
La Bible valorise la vérité (Pr 12,22), mais le neuvième commandement, « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Ex 20,16), interdit spécifiquement de mentir au tribunal pour nuire à autrui. La demi-vérité d’Abraham sur le fait que Sarah était sa sœur (Gn 20,12) était une question de survie et non de malveillance, et ne viole donc probablement pas ce commandement.
L’idée rabbinique de pikuach nefesh – sauverune vie est prioritaire par rapport à la plupart des commandements – est venue plus tard mais a des racines dans la Bible. Par exemple, Rahab a menti aux autorités de Jéricho pour protéger les espions israéliens (Jos 2, 4-6) et a été louée pour sa foi (Hé 11, 31). Shiphrah et Puah, les sages-femmes, ont trompé Pharaon pour sauver des bébés israéliens (Exode 1:15-21) et ont été bénies en retour. Tamar a usé de tromperie pour obtenir justice de Juda (Gn 38, 13-26), et ses actions ont conduit à la lignée du Messie (Mt 1, 3). Le mensonge d’Abraham sur le fait que Sarah était sa sœur (Gn 12, 12 ; 20, 11) était motivé par la crainte pour sa vie et la responsabilité de protéger ceux dont il avait la charge, face aux dangers réels que représentaient les rois étrangers. Ces histoires montrent que sauver des vies peut justifier la tromperie dans des circonstances extrêmes.
La droiture malgré l’imperfection
La droiture n’exige pas l’absence de péché. David, appelé « un homme selon le cœur de Dieu » (1 Sam 13:14, Actes 13:22), a commis l’adultère et le meurtre (2 Sam 11), mais Dieu a apprécié son dévouement et son repentir (Ps 51). La foi d’Abraham – en quittant Ur (Gn 12,1-4), en intercédant pour Sodome (Gn 18,22-33) et surtout en offrant Isaac (Gn 22,1-18) – lui a valu le titre d’ami de Dieu (Is 41,8 ; Jc 2,23). De même, Anne et Siméon, qualifiés de justes pour leur dévouement (Luc 2:25, 2:37), n’étaient pas sans péché mais fidèles. L’éloge que Dieu fait d’Abraham dans Genèse 26:5 reflète sa fidélité tout au long de sa vie, et non pas un rejet de ses défauts. Ce modèle montre que Dieu apprécie la foi et l’obéissance plutôt que la perfection.
Conclusion
La Genèse, fondement des chrétiens et des juifs, célèbre la foi d’Abraham et de Sarah tout en révélant leurs défauts. Craignant pour leur vie et celle des personnes dont ils avaient la charge, Abraham et Isaac ont trompé les dirigeants, mettant en péril l’honneur de leurs épouses. Pourtant, Dieu les a protégés, en utilisant des fléaux, des rêves ou des réprimandes, mettant ainsi en évidence sa grâce. Pour les Israélites libérés d’Égypte, ces histoires, écrites par Moïse, sont le reflet de leurs propres luttes et de la fidélité de Dieu. Situés dans une culture patriarcale où les femmes étaient des biens et où les harems avaient un poids politique, ces récits mettent en évidence l’alliance de Dieu qui perdure malgré l’imperfection humaine, et enseignent des leçons intemporelles sur la foi, la protection divine et la complexité des voyages spirituels.