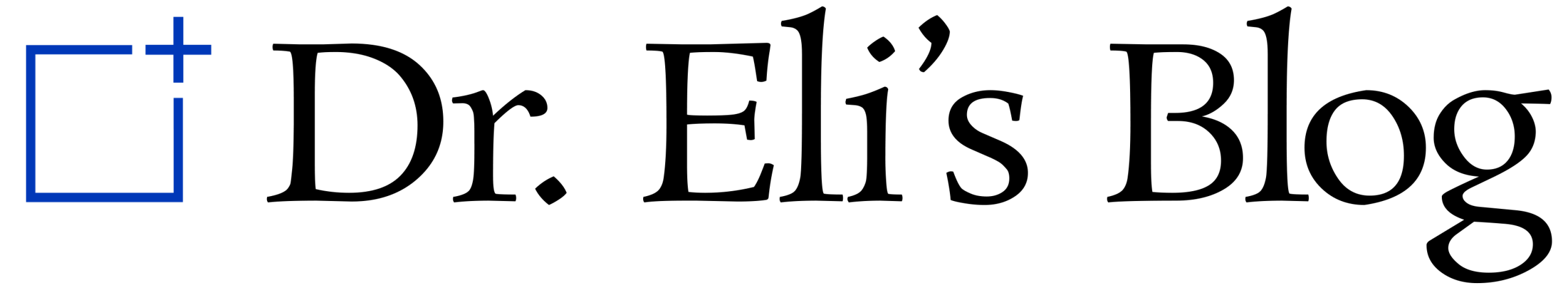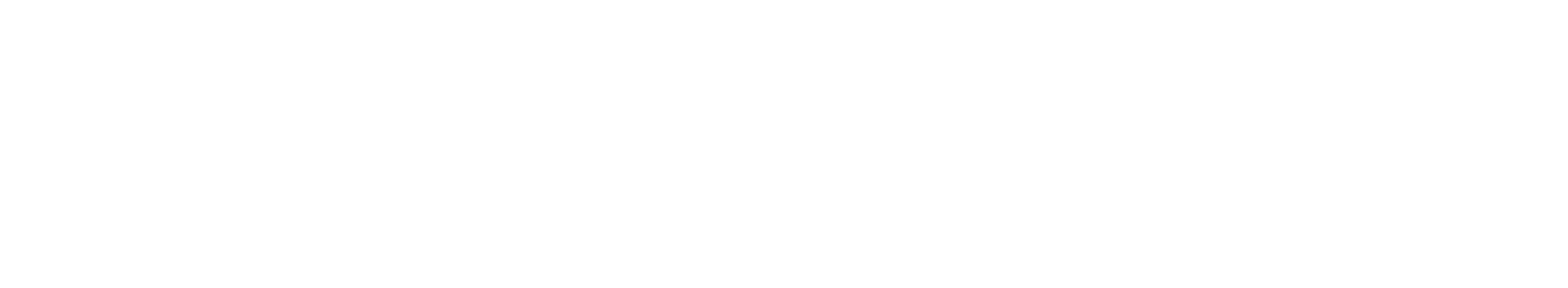Le récit des dix plaies et du « pillage des Égyptiens » dans le livre de l’Exode (chapitres 7-12) constitue un moment charnière dans la Bible hébraïque, illustrant la justice divine, la provision et la suprématie de Yahvé sur l’ordre socio-religieux de l’Égypte. Les plaies démantèlent systématiquement l’autorité des dieux égyptiens, révélant leur impuissance et perturbant le ma’at, l’ordre cosmique au cœur de la vision égyptienne du monde. Simultanément, le pillage – loin d’être un acte de vol – sert de transfert de richesse divinement orchestré, compensant les Israélites pour des siècles d’esclavage et les équipant pour leur voyage. Cet essai explore les dimensions théologiques et éthiques de ces événements, en montrant comment ils transforment les Israélites d’esclaves opprimés en une nation autonome, prête à accomplir son destin en vertu de l’alliance.
Les dix plaies
Les dix plaies (Exode 7-12) ne sont pas de simples catastrophes naturelles, mais des confrontations délibérées avec le panthéon égyptien, chacune ciblant le domaine d’une divinité pour affirmer le pouvoir inégalé de Yahvé. Les fléaux se déroulent selon une progression calculée, défaisant le tissu social, économique et religieux de l’Égypte tout en obligeant Pharaon et son peuple à reconnaître la souveraineté de Yahvé.
La première plaie transforme le Nil, vénéré comme la source de vie de l’Égypte par le dieu Hapi, en sang, paralysant l’agriculture et révélant l’impuissance d’Hapi. Le deuxième fléau libère des grenouilles, associées à Heqet, la déesse de la fertilité, qui se moquent de son autorité en envahissant le pays. Les poux et les mouches, troisième et quatrième fléaux, souillent les espaces sacrés, défiant Geb (la terre) et Khepri (la création). La cinquième plaie, la mort du bétail, ébranle Apis et Hathor, symboles de la force et de l’éducation, et détruit les fondements économiques de l’Égypte. Les furoncles, la sixième plaie, humilient Imhotep, le guérisseur divinisé, car aucun remède ne peut arrêter l’affliction. La grêle et les sauterelles, les septième et huitième fléaux, dévastent les récoltes, écrasant Nout (le ciel) et Osiris (la moisson), mettant à mal la stabilité agricole. Le neuvième fléau, l’obscurité, éclipse Râ, le dieu du soleil qui est au cœur du statut divin de Pharaon, et le prive de son autorité cosmique. Enfin, la mort des premiers-nés, y compris l’héritier de Pharaon, anéantit sa prétention à la divinité, tandis que Yahvé épargne les premiers-nés d’Israël, soulignant ainsi la protection que lui confère son alliance.
Chaque fléau vise un pilier de la théologie égyptienne, prouvant l’impuissance des dieux et perturbant la maât. Cet ordre cosmique, que les Égyptiens croyaient être défendu par leurs dieux, est montré comme étant sous le contrôle de Yahvé. L’effet cumulatif des fléaux oblige l’Égypte à se confronter à la réalité d’un Dieu unique et souverain, dont le pouvoir transcende leur panthéon.
Le pillage de l’Égypte
Alors que les Israélites se préparent à quitter l’Égypte, Exode 12:35-36 décrit un acte remarquable de justice divine : le « pillage des Égyptiens » Loin d’être un pillage, cet événement est un transfert d’or, d’argent et de vêtements divinement sanctionné, orchestré pour dédommager les Israélites de leurs souffrances et les équiper pour leur voyage dans le désert. Dieu ordonne aux Israélites de demander des objets de valeur à leurs voisins égyptiens qui, ébranlés par les fléaux et poussés par la faveur divine, s’exécutent volontiers (Exode 3:21-22 ; 12:36).
Le verbe hébreu natsal, souvent traduit par « piller », signifie d’abord « délivrer » ou « sauver », créant un jeu de mots délibéré avec la délivrance d’Israël de l’esclavage par Dieu (Exode 3:8). Ce lien linguistique présente le pillage comme une extension de la libération divine, transformant les anciens esclaves en une communauté autonome. Le terme chen (faveur), enraciné dans chanan (être bienveillant), souligne l’intervention divine, Dieu accordant aux Israélites une faveur aux yeux des Égyptiens (Exode 11:3). Cette faveur, qui mêle crainte et effroi, incite les Égyptiens à se conformer, conformément aux pratiques du Proche-Orient ancien qui consistaient à approvisionner les groupes en partance.
Le pillage a plusieurs objectifs. Tout d’abord, il met en œuvre la justice divine, en dédommageant les Israélites pour des siècles de travail non rémunéré et d’oppression, y compris le décret génocidaire contre leurs enfants mâles (Exode 1:16). Elle accomplit la promesse faite par Dieu à Abraham, selon laquelle ses descendants quitteraient le pays de leurs oppresseurs « avec de grandes possessions » (Genèse 15:14). Deuxièmement, il fournit des ressources pratiques – de l’or, de l’argent et des vêtements – pour survivre dans le désert, assurant ainsi la viabilité économique. Troisièmement, les richesses sont ensuite réaffectées au culte divin, utilisées pour construire le Tabernacle (Exode 35:20-29), transformant les ressources idolâtres de l’Égypte en instruments au service de Yahvé.
Considérations éthiques sur le pillage
Le terme « pillage » peut suggérer une acquisition contraire à l’éthique, mais le récit présente le transfert comme n’étant ni trompeur ni coercitif. La volonté des Égyptiens, influencée par le bilan psychologique des fléaux et la faveur divine, reflète une réponse culturellement crédible. Dans les sociétés du Proche-Orient ancien, les échanges de richesses accompagnaient souvent les transitions sociales, telles que la libération des esclaves. Les traditions juives, y compris les sources bibliques et talmudiques, considèrent la richesse comme une compensation légitime pour l’esclavage, ce qui renforce son fondement éthique.
Les critiques pourraient remettre en question la moralité de la prise des richesses égyptiennes, mais le texte met l’accent sur l’orchestration divine plutôt que sur l’action humaine. Les Israélites ne trompent pas les Égyptiens et ne les obligent pas à se plier à leurs exigences ; au contraire, les Égyptiens, humiliés par la puissance de Yahvé, fournissent volontiers les objets demandés. Cet acte s’inscrit dans le thème plus large de la justice divine, où les outils d’oppression – les richesses de l’Égypte – sont réaffectés à la rédemption et à l’adoration.
Les fléaux et le pillage sont intimement liés, formant un récit cohérent de la puissance et de la provision divines. Les fléaux démantèlent l’ordre religieux et social de l’Égypte, établissant la suprématie de Yahvé, tandis que le pillage donne du pouvoir aux Israélites, les équipant pour leur rôle dans l’alliance. Ensemble, ces événements accomplissent la promesse de Dieu à Abraham, transformant des siècles de souffrance en un héritage de rédemption.
D’un point de vue théologique, les fléaux soulignent la souveraineté de Yahvé sur la création et l’histoire, remettant en question les systèmes idolâtres qui oppriment son peuple. Le pillage, quant à lui, illustre sa provision holistique – la libération spirituelle associée au soutien matériel. L’or, l’argent et les vêtements, autrefois symboles de la domination égyptienne, deviennent des outils d’adoration et de survie, incarnant un profond renversement de pouvoir.
Sur le plan narratif, ces événements marquent un tournant pour les Israélites. Ils quittent l’Égypte non pas comme des fugitifs démunis, mais comme une nation digne, dotée de richesses et d’un but. Le pillage, en particulier, souligne leur transformation d’esclaves en une communauté d’alliance, prête à construire le tabernacle et à adorer Yahvé dans le désert. Cet acte de délivrance résonne avec le thème biblique plus large de la fidélité de Dieu, qui transforme l’oppression en opportunité.
Conclusion
Les dix plaies et le pillage de l’Égypte dans l’Exode tissent un récit puissant de la justice, de la provision et de la suprématie divines. Les plaies démantèlent systématiquement les dieux et la maât de l’Égypte, affirmant la puissance inégalée de Yahvé, tandis que le pillage dédommage les Israélites de leurs souffrances et les équipe pour leur voyage. Loin d’être un acte de vol, le transfert des richesses est un acte de justice divinement sanctionné, enraciné dans la promesse de Dieu à Abraham et accompli par sa faveur. L’or, l’argent et les vêtements, autrefois symboles de l’oppression égyptienne, deviennent des instruments d’adoration et de subsistance, signifiant un profond renversement de pouvoir. Lorsque les Israélites s’avancent dans le désert, ils emportent non seulement des richesses matérielles, mais aussi un témoignage de la fidélité de Dieu, qui leur donne les moyens de vaincre, de reconstruire et d’accomplir la destinée qui leur a été promise par l’alliance. Ce récit invite à réfléchir à la vérité durable selon laquelle la justice divine prévaut, transformant les outils d’oppression en ressources pour le renouveau et l’adoration.