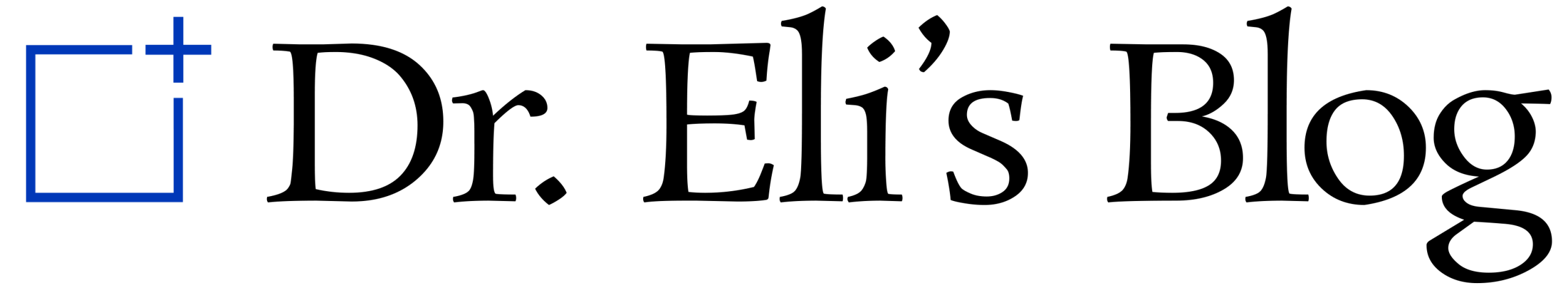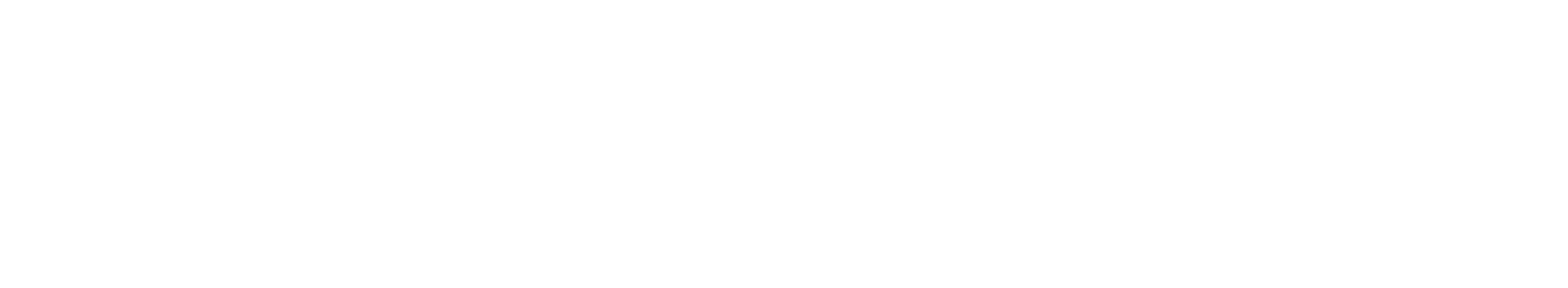Le fossé entre les Samaritains et les Judéens : Contexte historique et religieux
La rencontre entre Jésus et la Samaritaine au puits de Jacob à Sychar (Jean 4,5-6) est imprégnée de l’animosité historique entre les Samaritains et les Judéens, un fossé qui remonte à la conquête assyrienne du royaume du nord d’Israël (722 avant notre ère). Les Samaritains, descendants d’Israélites mêlés à des colons étrangers (2 Rois 17:24-41), ont développé une identité religieuse distincte centrée sur le Mont Gerizim, où ils ont construit un temple rivalisant avec celui de Jérusalem (Josèphe, Antiquités des Juifs 11.310-311). À l’époque du Second Temple (516 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.), les Samaritains adhèrent à leur propre version de la Torah, rejetant les livres prophétiques et le Temple de Jérusalem comme seul lieu de culte légitime.
Cette divergence théologique a alimenté l’hostilité mutuelle. Les Judéens considéraient les Samaritains comme rituellement impurs et théologiquement déviants, tandis que les Samaritains se considéraient comme les véritables gardiens de la foi israélite, préservant l’ancien lieu de culte choisi par Josué (Deutéronome 11:29 ; Josué 8:33). La question de la Samaritaine en Jean 4,20 – » Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous prétendez que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem » – touche au cœur de ce différend, reflétant des siècles de revendications concurrentes sur l’espace sacré et la faveur divine.
La réponse de Jésus en Jean 4:21-24 est révolutionnaire : « Un temps vient où vous n’adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem… Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité » Cette déclaration transcende les frontières géographiques et ethniques qui définissaient le conflit entre les Samaritains et les Judéens, indiquant une nouvelle ère d’adoration centrée sur la réalité spirituelle de la présence de Dieu. Cependant, sa déclaration, « le salut vient des Juifs » (Jean 4:22), ancre cette vision universelle dans la particularité de l’histoire de l’alliance d’Israël, et plus particulièrement de la tribu de Juda. Pour éclaircir ce point, nous devons aborder la triple explication fournie, en la situant dans le milieu théologique et culturel du premier siècle.
Premièrement : La diversité du judaïsme du premier siècle
L’affirmation selon laquelle « le judaïsme (rabbinique) contemporain n’est pas identique au(x) judaïsme(s) du premier siècle » est essentielle pour comprendre la déclaration de Jésus. Le judaïsme du Second Temple n’était pas une tradition monolithique, mais une mosaïque vivante de sectes et d’idéologies, comprenant les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et divers mouvements messianiques. Ces groupes différaient sur des questions relatives au culte du temple, à l’interprétation des Écritures et aux attentes eschatologiques. Les Pharisiens mettaient l’accent sur la tradition orale et la résurrection, les Sadducéens adhéraient strictement à la Torah et rejetaient les croyances sur la vie après la mort, et les Esséniens recherchaient la pureté ascétique dans l’attente d’une intervention divine (Josèphe, Guerre juive 2.119-166).
Au sein de cette diversité, les juifs qui suivaient Jésus disposaient d’un large espace idéologique. Les premières communautés chrétiennes, telles que celles décrites dans le livre des Actes, étaient majoritairement juives et voyaient en Jésus l’accomplissement des espoirs prophétiques d’Israël (Actes 2:36 ; 3:18-26). Des personnalités comme Jacques, Pierre et Paul agissaient dans le cadre juif, observant la Torah et participant au culte du temple tout en proclamant que Jésus était le Messie (Actes 21,20-26). Le rejet de Jésus par certains dirigeants juifs, en particulier la prêtrise sadducéenne (Marc 14, 55-64), ne représentait pas une position universelle. Ainsi, l’assimilation du judaïsme rabbinique moderne – codifié après la destruction du Temple en 70 de notre ère dans la Mishnah et le Talmud – au judaïsme du premier siècle simplifie à l’excès la réalité historique et obscurcit les racines juives du mouvement de Jésus.
L’alignement de Jésus sur « ce que nous [les Juifs] savons » en Jean 4:22 reflète son affirmation de la tradition judéenne de l’alliance, en particulier les promesses prophétiques liées à Jérusalem et à la lignée davidique. Cela ne nie pas la foi samaritaine, mais souligne le rôle unique de Juda dans le plan de rédemption de Dieu, comme nous le verrons plus loin.
Deuxièmement : le concept biblique du salut
Le deuxième point redéfinit le salut dans son contexte biblique, distinct des notions occidentales modernes de délivrance personnelle de l’enfer.Dans le judaïsme du Second Temple, le salut (yeshuah en hébreu) était inextricablement lié au règne eschatologique de Dieu, à la restauration d’Israël et à l’établissement de la justice divine sur les nations. Cette vision, exprimée par des prophètes comme Isaïe, Jérémie et Zacharie, anticipait un roi messianique qui inaugurerait le royaume de Dieu, apportant la paix, la justice et l’adoration universelle (Isaïe 2,2-4 ; Zacharie 9,9-10).
Par exemple, Isaïe 49:6 décrit le serviteur d’Israël comme une « lumière pour les nations, afin que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » Ce salut englobe la restauration des tribus d’Israël et l’inclusion des nations dans l’alliance de Dieu. De même, le Psaume 72 dépeint le roi davidique idéal dont le règne apporte la justice et la prospérité à tous les peuples. Dans ce cadre, le salut est collectif et cosmique, et non simplement individuel, et vise à aligner la terre sur l’ordre divin du ciel (Matthieu 6:10).
Le ministère de Jésus incarne cette vision prophétique. Ses miracles, ses enseignements et sa proclamation du royaume de Dieu (Marc 1:15) signalent l’avènement du règne de Dieu. En déclarant que « le salut vient des Juifs », Jésus souligne le rôle du peuple juif en tant que porteur de l’alliance de Dieu, à travers lequel le Messie – lui-même – émerge pour accomplir ces promesses. La Samaritaine, imprégnée de ses propres attentes fondées sur la Torah, aurait reconnu les sous-entendus messianiques des paroles de Jésus, ce qui l’aurait incitée à partager la rencontre avec sa communauté (Jean 4,28-29).
Troisièmement : la promesse prophétique à Juda
Le troisième point relie la déclaration de Jésus à la bénédiction de Jacob dans Genèse 49, 8-10, un texte fondamental dans les Torahs judéenne et samaritaine : « Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le bâton du chef d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne celui à qui il appartient et que les nations lui obéissent Cette prophétie désigne Juda comme la tribu destinée à produire l’ultime roi d’Israël, dont le règne s’étend aux nations. Dans le judaïsme du Second Temple, ce passage était largement interprété comme messianique, alimentant l’attente d’un libérateur davidique (cf. Psaumes de Salomon 17,21-23).
Le Nouveau Testament lie explicitement cette prophétie à Jésus. Le livre de l’Apocalypse l’appelle « le Lion de la tribu de Juda » (Apocalypse 5:5), et Hébreux 7:14 affirme que « notre Seigneur est descendu de Juda » Dans Jean 4:22, la référence de Jésus au salut « par les Juifs » est un raccourci de cette promesse spécifique aux Judéens. Si les Samaritains révéraient la Torah et attendaient un prophète comme Moïse (Deutéronome 18:15), leur tradition ne mettait pas l’accent sur un messie judéen. Les paroles de Jésus corrigent doucement la perspective de la Samaritaine, en affirmant que le leader salvateur – lui-même – vient de Juda, accomplissant la prophétie de Jacob.
Cette affirmation n’est pas exclusive mais inclusive. En s’identifiant comme le Messie (Jean 4,25-26), Jésus comble le fossé entre les Samaritains et les Judéens, offrant le salut à tous ceux qui adorent « en esprit et en vérité » La réponse positive de la communauté samaritaine (Jean 4:39-42) souligne la portée universelle de sa mission, puisqu’elle le reconnaît comme « le Sauveur du monde »
Signification théologique et culturelle
La conversation de Jésus avec la Samaritaine est un microcosme de sa mission plus large qui consiste à réconcilier l’humanité avec Dieu. Son engagement avec une Samaritaine – une étrangère aux yeux des Judéens – reflète la nature inclusive du royaume, qui englobe à la fois Israël et les nations (Matthieu 28:19-20). Cependant, son affirmation du rôle de Juda préserve la particularité de l’alliance de Dieu avec Israël, à travers laquelle le Messie émerge. Cet équilibre entre particularité et universalité est au cœur de la théologie johannique, comme le montrent Jean 1,11-12 et 3,16.
Sur le plan culturel, la connaissance nuancée que Jésus a des traditions samaritaines et judéennes démontre sa capacité à naviguer dans les complexités du judaïsme du Second Temple. Sa référence à « ce que nous savons » s’aligne sur l’accent mis par les Judéens sur l’alliance davidique, tandis que son ouverture à la Samaritaine reflète la vision prophétique d’un Israël restauré qui inclut toutes les tribus (Ezéchiel 37, 15-22). Le dialogue sert donc de pont théologique, unissant des communautés disparates sous la bannière de l’espérance messianique.
Conclusion
La déclaration de Jésus, « le salut vient des Juifs », résume l’interaction profonde entre l’histoire de l’alliance et la promesse eschatologique. Elle affirme la diversité du judaïsme du premier siècle, qui a fourni un foyer aux disciples de Jésus ; elle redéfinit le salut comme le règne cosmique de Dieu plutôt que comme une évasion individuelle ; et elle enracine l’identité du Messie dans la bénédiction prophétique de Juda. Pour la Samaritaine et sa communauté, cette rencontre avec le Christ juif a été transformatrice, les amenant à le reconnaître comme le Sauveur tant attendu. Pour les lecteurs modernes, elle souligne les racines juives de la foi chrétienne et la portée universelle du plan rédempteur de Dieu, accompli dans le Lion de Juda qui règne sur toutes les nations.