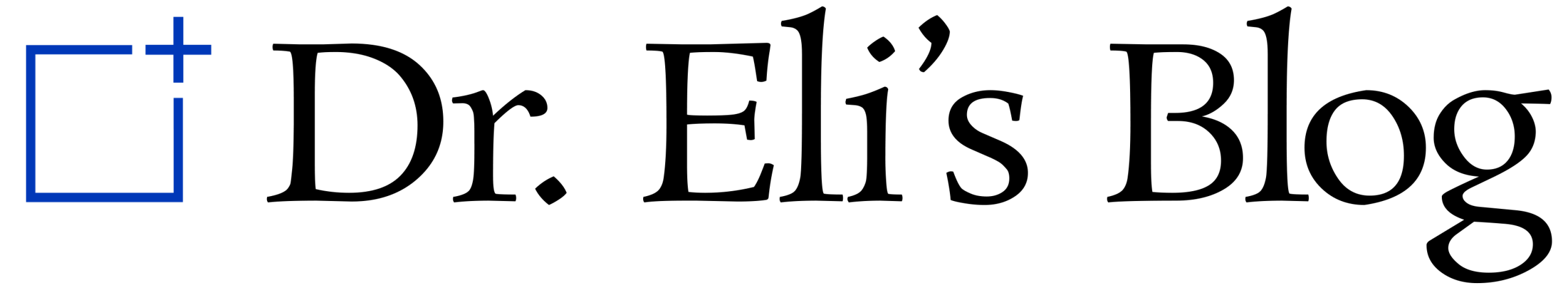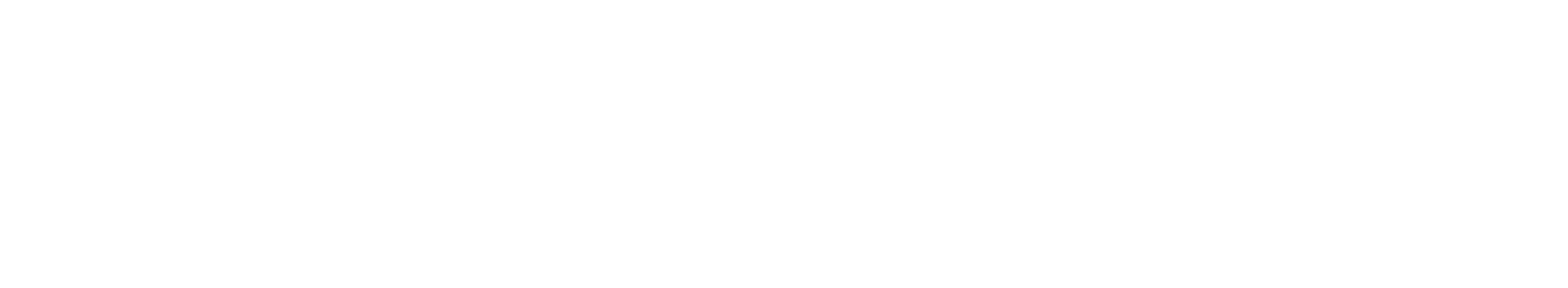La déclaration de Jésus dans Matthieu 5:34-37, qui fait partie du Sermon sur la montagne, est souvent interprétée comme une interdiction générale de prêter serment, exhortant les croyants à adopter la simple vérité : que votre « oui » soit « oui » et que votre « non » soit « non » Cette interprétation risque toutefois de simplifier à l’extrême un enseignement profondément ancré dans son contexte juif. Plutôt que d’introduire un nouveau commandement, Jésus réaffirme et recentre les principes de la Torah sur la véracité, la sainteté du nom de Dieu et l’intégrité de la parole humaine. En examinant les pratiques historiques de prestation de serment, le contexte scripturaire et les implications théologiques, nous pouvons mieux comprendre les paroles de Jésus comme un appel à limiter les serments aux circonstances extraordinaires, à ne jurer que par le nom de Dieu lorsque c’est nécessaire, et à donner la priorité à l’honnêteté sans fioritures dans la vie quotidienne.
Le contexte du serment dans l’ancien Israël
Dans l’ancien Israël, les serments et les vœux étaient des engagements sérieux, invoquant souvent l’autorité divine pour garantir la véracité d’une déclaration ou l’accomplissement d’une promesse. La Torah fournit des lignes directrices claires pour de telles pratiques. Nombres 30:2 déclare : « Lorsqu’un homme fait un vœu à l’Éternel ou qu’il s’engage par un serment, il ne doit pas manquer à sa parole, mais il doit faire exactement ce qu’il a promis » Cela souligne la nature contraignante des serments, en particulier ceux qui sont faits au nom de Dieu. De même, Exode 20:7, le troisième commandement, interdit de prendre le nom du Seigneur en vain, ce qui inclut de l’utiliser de manière frivole ou mensongère dans les serments. Ces textes établissent que les serments n’étaient pas occasionnels ; il s’agissait d’actes sacrés destinés à refléter la relation d’alliance entre Dieu et son peuple.
Cependant, à l’époque du Second Temple, la prestation de serment est devenue plus complexe. Les sources juives, telles que la Mishna (par exemple, Shevuot 3-4), révèlent que les gens juraient souvent par des entités de moindre importance – le ciel, la terre, Jérusalem ou même des objets personnels – pour éviter d’avoir à invoquer le nom de Dieu. Ces « serments de substitution » étaient considérés comme moins contraignants et permettaient aux individus de faire des promesses avec des lacunes. Par exemple, jurer « par le ciel » pouvait être considéré comme moins obligatoire que jurer « par le Seigneur », créant ainsi une hiérarchie de serments qui nuisait à leur objectif. Cette pratique favorisait la malhonnêteté, car les gens pouvaient faire des déclarations grandioses sans avoir l’intention d’y donner suite, en exploitant des détails techniques pour échapper à leur responsabilité.
L’enseignement de Jésus dans Matthieu 5:34-37 aborde directement cet abus. Il énumère des entités spécifiques souvent utilisées dans les serments – « ciel », « terre », « Jérusalem » et même « ta tête » – et les déclare invalides en tant que bases de serment. Pourquoi ? Parce que chacune de ces entités est intimement liée à Dieu : le ciel est son trône, la terre son marchepied, Jérusalem la ville du grand Roi, et même la tête d’une personne est soumise à la souveraineté divine. En les invoquant, les gens invoquaient indirectement Dieu tout en prétendant éviter son nom, une forme d’hypocrisie que Jésus condamne. Son propos n’est pas d’interdire tous les serments, mais d’exposer la futilité des serments évasifs et de réorienter les croyants vers l’intention originelle de la Torah : la véracité et la révérence pour le nom de Dieu.
L’enseignement de Jésus, un retour à la Torah
Loin d’abolir le serment, Jésus rappelle que la Torah met l’accent sur l’intégrité. Dans Matthieu 5:17, il déclare : « Ne croyez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes ; je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir » Son enseignement sur les serments s’inscrit dans cette mission. La Torah autorisait et même exigeait des serments dans certains contextes, tels que les procédures judiciaires (par exemple, Ex. 22:11) ou les engagements contractuels (par exemple, Gen. 21:23-24). Cependant, elle exigeait que les serments soient faits solennellement et qu’ils soient respectés fidèlement. Le Deutéronome 6:13 dit : « Crains le Seigneur ton Dieu, ne le sers que lui, et prête serment en son nom », soulignant que seul le nom de Dieu a l’autorité de lier un serment.
L’interdiction faite par Jésus de jurer « par le ciel, la terre ou Jérusalem » renforce ce principe. En énumérant ces substituts, il élimine les failles qui permettaient aux gens de faire des promesses insincères. Son commandement de « ne pas faire de serment du tout » n’est pas absolu mais hyperbolique, un procédé rhétorique courant dans l’enseignement juif pour souligner un point. L’essentiel de son instruction se trouve au verset 37 : que votre déclaration soit : « Oui, oui » ou « Non, non » ; tout ce qui est en dehors de cela est un mal L’expression « du mal » suggère que les jurons excessifs ou évasifs proviennent d’un cœur trompeur, faisant écho à la préoccupation de la Torah pour la véracité (par exemple, Lev. 19:11-12).
Cette interprétation est étayée par d’autres textes bibliques. Le Psaume 63:11 déclare : « Quiconque jure par Dieu exulte, car la bouche des menteurs se tait », affirmant que les serments faits au nom de Dieu sont honorables lorsqu’ils sont véridiques. De même, le prophète Jérémie met en garde contre les faux serments : « S’ils disent : Le Seigneur est vivant, ils jurent faussement » (Jérémie 5:2). Ces passages soulignent que le problème n’est pas l’acte de jurer mais l’intégrité qui le sous-tend. L’enseignement de Jésus appelle donc les croyants à une norme plus élevée : parler avec une telle honnêteté que les serments deviennent largement inutiles.
Les serments dans le Nouveau Testament : L’exemple de Paul
Le Nouveau Testament précise que l’enseignement de Jésus n’interdit pas tous les serments. L’apôtre Paul, juif dévot et disciple du Christ, invoque Dieu comme témoin à plusieurs reprises. Dans Galates 1:20, défendant son intégrité apostolique, il écrit : « Je vous assure devant Dieu que ce que je vous écris n’est pas un mensonge » De même, en 2 Corinthiens 1:23, il déclare : « J’en prends Dieu à témoin – et je mets ma vie en jeu – que c’est pour vous épargner que je ne suis pas retourné à Corinthe. » Ces exemples montrent que Paul, imprégné des enseignements de Jésus, ne voyait aucune contradiction à jurer par le nom de Dieu dans des circonstances extraordinaires où la vérité avait besoin d’être affirmée.
Jésus lui-même répond à un serment dans un contexte juridique. Lors de son procès devant le grand prêtre, Jésus répond directement lorsqu’on l’adjure « par le Dieu vivant » de déclarer s’il est le Messie (Matt. 26:63-64). Son silence jusqu’à ce moment et sa réponse véridique suggèrent qu’il respectait la solennité d’un serment fait au nom de Dieu, même s’il en critiquait l’abus occasionnel. Ces exemples montrent que l’enseignement de Jésus vise à limiter les serments à des situations rares et nécessaires, en veillant à ce qu’ils soient prononcés avec révérence et vérité.
Implications théologiques : La vérité, reflet du caractère de Dieu
L’accent mis par Jésus sur la simple vérité – « Oui, oui » ou « Non, non » – a de profondes implications théologiques. Dans le Sermon sur la montagne, il appelle ses disciples à une justice qui surpasse celle des pharisiens (Matt. 5:20), non pas par des rituels extérieurs mais par une transformation intérieure. Les paroles véridiques reflètent le caractère de Dieu, car Dieu est la vérité elle-même (Jean 14:6). Lorsque les croyants parlent honnêtement, ils incarnent l’image divine et répondent à l’appel de l’alliance à être un peuple saint (Ex. 19:6).
L’usage abusif des serments, en revanche, s’aligne sur le « mal » parce qu’il déforme la vérité de Dieu. Dans la vision juive du monde, les mots sont porteurs d’un pouvoir créateur, faisant écho à l’acte de Dieu qui a donné naissance au monde (Gn 1,3). Les serments faux ou frivoles abusent de ce pouvoir, sapant la confiance et la communauté. L’enseignement de Jésus rétablit donc le caractère sacré de la parole humaine, exhortant les croyants à aligner leurs paroles sur leurs actes et leurs cœurs sur la volonté de Dieu.
Application pratique : Les serments dans des circonstances extraordinaires
Si Jésus donne la priorité à la véracité plutôt qu’au serment, il n’élimine pas complètement la possibilité de prêter serment. Les écrits bibliques suggèrent que les serments restent autorisés dans des circonstances extraordinaires, telles que les témoignages juridiques, les accords d’alliance ou les moments nécessitant une affirmation solennelle. Cependant, ils doivent être prononcés au seul nom de Dieu, avec un engagement total à les accomplir. Ce principe est évident dans Hébreux 6:16-17, qui note que les gens jurent par Dieu pour confirmer les promesses, et que Dieu lui-même a prêté serment à Abraham pour garantir son alliance (Gen. 22:16-18).
Pour les croyants d’aujourd’hui, cet enseignement remet en question l’utilisation désinvolte de promesses ou d’assurances exagérées (« Je jure que je le ferai ! »). Au contraire, il appelle à l’intégrité dans le discours de tous les jours, où la parole est fiable et n’a pas besoin d’être enjolivée. Dans de rares cas, tels que les témoignages devant les tribunaux ou les vœux sacrés (par exemple, le mariage), les serments peuvent encore avoir une utilité, à condition qu’ils soient prononcés avec respect et sincérité.
Conclusion
L’enseignement de Jésus sur les serments dans Matthieu 5:34-37 n’est pas un rejet des serments mais une réforme de leur pratique. Enraciné dans l’appel de la Torah à la vérité et au respect du nom de Dieu, il critique les serments évasifs et malhonnêtes de son époque, exhortant les croyants à limiter les serments aux situations extraordinaires et à ne jurer que par Dieu. Par-dessus tout, il élève la simple honnêteté, où « oui » veut dire oui et « non » veut dire non, au rang de marque d’un cœur transformé. Cet enseignement nous incite à refléter la vérité de Dieu dans nos paroles, en favorisant la confiance et l’intégrité dans nos relations et nos communautés.