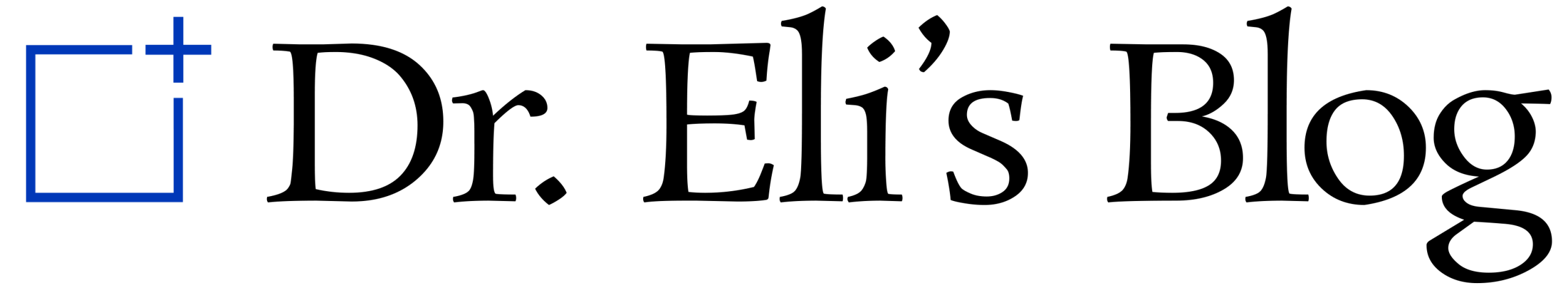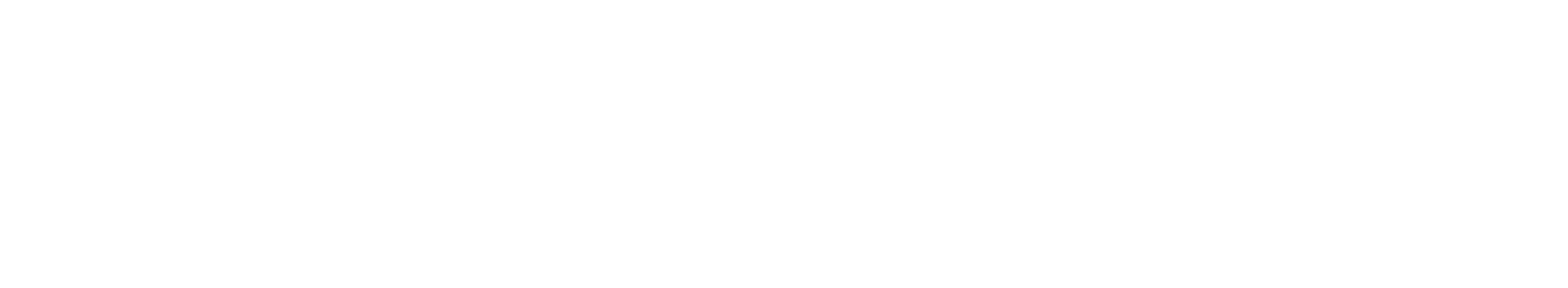L’idée que Marie, la mère de Jésus, puisse être considérée comme une « nouvelle Ève » dans la théologie chrétienne est une proposition convaincante qui a résonné pendant des siècles dans la pensée chrétienne, en particulier dans la tradition catholique. Cette idée, enracinée dans l’Évangile de Jean et amplifiée par les premiers Pères de l’Église, établit des parallèles entre Marie et Ève, la première femme de la Bible hébraïque, suggérant que l’obéissance de Marie et son rôle de mère de Jésus inversent la désobéissance d’Ève et ses conséquences. Toutefois, les preuves textuelles et historiques de cette identification doivent être examinées avec soin. Cet essai explore la base biblique du concept de « nouvelle Ève », en se concentrant sur l’adresse de Jésus à Marie en tant que « femme » dans l’Évangile de Jean, sur les liens symboliques entre Marie, Ève et l’imagerie de la vie, et sur le témoignage des premiers écrivains chrétiens, tout en évaluant de manière critique si le Nouveau Testament, en particulier les écrits de Paul, soutient cette typologie.
Jésus parle de Marie comme d’une « femme » dans l’Évangile de Jean
L’Évangile de Jean fournit le premier fondement scripturaire pour considérer Marie comme une Nouvelle Ève, en particulier à travers deux épisodes où Jésus s’adresse à sa mère en tant que « femme » (γυνή, gunē) : les Noces de Cana (Jean 2,1-11) et la Crucifixion (Jean 19,25-28). À Cana, lorsque le vin vient à manquer, Marie fait remarquer à Jésus : « Ils n’ont pas de vin », ce à quoi il répond : « Qu’en est-il de moi et de toi, femme ? Mon heure n’est pas encore venue » (Jean 2:4). Malgré cette réponse apparemment tranchante, Marie demande aux serviteurs de suivre les instructions de Jésus, ce qui aboutit au miracle de la transformation de l’eau en vin. Sur la croix, Jésus appelle à nouveau Marie « femme » en disant : « Femme, voici ton fils », la confiant au disciple bien-aimé, et au disciple : « Voici ta mère » (Jean 19:26-27). Ce sont les deux seules fois dans le Nouveau Testament où Jésus s’adresse directement à sa mère, ce qui rend l’utilisation du terme « femme » significative.
Au départ, le terme « femme » peut sembler irrespectueux, en particulier dans les contextes modernes, car il semble éloigner Jésus de sa mère. Cependant, comme l’indiquent Liddell et Scott’s Greek-English Lexicon, le vocatif gunē peut véhiculer le respect ou l’affection dans l’usage grec, une nuance confirmée par son application à d’autres femmes dans les Évangiles sans intention péjorative (par exemple, Matthieu 15:28, Luc 13:12, Jean 4:21). Le choix de « femme » plutôt que de « mère » signale probablement un changement dans le rôle de Marie lorsque Jésus commence son ministère messianique public à Cana et l’achève à la croix. À Cana, le terme marque le passage d’une relation familiale à une relation théologique, soulignant le rôle de Marie dans le déroulement de la mission de Jésus. À la croix, il souligne son nouveau rôle de mère spirituelle du disciple bien-aimé et, par extension, de l’Église.
L’utilisation du terme « femme » fait écho à la description d’Ève dans la Bible hébraïque, qui est appelée isha (אִשָּׁה, femme) dix fois dans la Genèse (par exemple, Genèse 2:23) mais nommée Hava (חַוָּה, donneuse de vie) seulement deux fois (Genèse 3:20, 4:1). La traduction grecque de isha dans la Septante est gunē, le même terme que celui utilisé pour Marie dans Jean. En outre, le nom d’Ève, dérivé de la racine hébraïque signifiant « vie » (hayim), la relie au fait de donner la vie, un thème qui résonne avec le rôle de Marie en tant que mère de Jésus, la source de la vie éternelle (Jean 6:35-56, 15:1-9). Le parallèle est encore renforcé par la présence du vin dans les deux scènes johanniques, un symbole lié à la vie et au sang de Jésus, ce qui suggère un lien théologique délibéré entre Marie et Ève.
Marie, la vie et le vin : Un lien symbolique
Le motif du vin dans Jean 2 et Jean 19 renforce le lien potentiel entre Marie et Ève en tant que donneuses de vie. À Cana, l’intervention de Marie provoque le premier miracle de Jésus, qui transforme l’eau en vin, symbole d’abondance et de joie dans la tradition juive. Sur la croix, après avoir confié Marie au disciple bien-aimé, Jésus dit : « J’ai soif » et reçoit du vin aigre (vinaigre) avant de déclarer : « Tout est accompli » (Jean 19,28-30). Cette séquence est significative, car le vin aigre évoque la « coupe de la colère de Dieu » (Isaïe 51:22), symbolisant l’acceptation par Jésus du péché de l’humanité. La juxtaposition du vin au début et à la fin du ministère de Jésus, en présence de Marie dans les deux cas, suggère un arc narratif dans lequel elle participe à sa mission de donner la vie.
En Jean 6, 53-56, Jésus assimile sa chair et son sang à la vraie nourriture et à la vraie boisson, en déclarant : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous-mêmes. » De même, dans Jean 15, 1-9, Jésus s’identifie comme la « vraie vigne », liant sa mission à l’image du vin et de la vie. Luc 22,20 et 1 Corinthiens 11,25 relient encore le vin au sang de Jésus et à la nouvelle alliance. La présence de Marie à Cana, à l’origine du miracle du vin, et à la croix, où Jésus boit du vin aigre, fait d’elle une figure associée à la transmission de la vie, tout comme Ève, dont le nom signifie « mère de tous les vivants » (Genèse 3:20). Si Jésus est le premier à donner la vie, le rôle de Marie en tant que mère la lie à cette mission, suggérant une participation secondaire mais significative.
Les premiers Pères de l’Église et la tradition de la nouvelle Ève
L’identification de Marie à une nouvelle Ève n’est pas simplement une construction théologique moderne, mais apparaît très tôt dans la pensée chrétienne. Les Pères de l’Église du deuxième siècle établissent explicitement ce parallèle, soulignant l’obéissance de Marie comme contrepoint à la désobéissance d’Ève. Justin Martyr, qui écrivait vers 160 de notre ère, affirme que Jésus, né de la Vierge Marie, renverse la désobéissance initiée par Ève, qui « conçut la parole du serpent » et engendra la mort, tandis que Marie, par sa foi, enfanta le Fils de Dieu (Dialogue avec Trypho, 100). Irénée de Lyon, vers 180 de notre ère, précise : « Le nœud de la désobéissance d’Ève a été défait par l’obéissance de Marie » (Contre les hérésies, III.22.4). Il oppose en outre la transgression d’Ève à l’acceptation par Marie de la parole de Dieu par l’intermédiaire de l’ange Gabriel (Contre les hérésies, V.19.1). Tertullien, également au deuxième siècle, note que la foi de Marie efface la délinquance d’Ève, puisque Marie a porté celui qui assurerait le salut (The Flesh of Christ, 17). Au quatrième siècle, Augustin renforce cette typologie en déclarant que « de même que la mort nous vient par une femme, la vie nous naît par une femme » (Combat chrétien 22.24).
Ces premières interprétations, apparues un siècle ou deux après les Évangiles, suggèrent que le concept de la Nouvelle Ève n’est pas un développement tardif, mais un reflet de la réflexion des premiers chrétiens sur le rôle de Marie. Bien que l’Évangile de Jean n’appelle pas explicitement Marie la « Nouvelle Ève », l’utilisation répétée du mot « femme » et l’imagerie de la vie associée au vin fournissent un fondement à cette interprétation, que les Pères de l’Église ont développée sur le plan théologique.
Le point de vue de Paul et le rôle d’Ève
L’examen des écrits de l’apôtre Paul, qui ne relie pas explicitement Marie à Ève, pose un problème crucial à l’hypothèse de la nouvelle Ève. Dans Romains 5:12-21 et 1 Corinthiens 15:20-23, Paul attribue la chute à Adam seul, déclarant : « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort » (Romains 5:12) et « Car de même qu’en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants » (1 Corinthiens 15:22). Ève est notablement absente de ces passages, ce qui suggère que Paul considère Adam comme l’agent principal de la chute. Toutefois, dans 1 Timothée 2:13-14, Paul reconnaît le rôle d’Ève, notant que « ce n’est pas Adam qui a été séduit, mais c’est la femme qui a été séduite et qui est devenue une malfaiteur » Cela indique que Paul est conscient de la participation d’Ève à la chute, même s’il souligne la responsabilité d’Adam dans d’autres contextes.
La question qui se pose est la suivante : lorsque Paul parle d' »Adam », s’agit-il d’Adam seul, ou bien utilise-t-il « Adam » pour désigner à la fois Adam et Ève, conformément aux conventions littéraires de son époque ?Le concept juif des « mérites des pères » (zechut avot), discuté précédemment, inclut implicitement les matriarches, malgré la terminologie patriarcale. De même, l’accent mis par Paul sur Adam peut englober Ève, car leurs actions dans Genèse 3 sont liées – Ève mange le fruit en premier, mais la participation d’Adam complète la transgression. L’absence d’un lien explicite entre Marie et Ève dans les écrits de Paul n’exclut pas la possibilité que l’Évangile de Jean, avec sa perspective théologique distincte, ait voulu une telle typologie. L’accent mis par Paul sur le Christ en tant que Nouvel Adam (Romains 5,14 ; 1 Corinthiens 15,45) laisse la place à un parallèle complémentaire entre Marie et Eve dans d’autres textes du Nouveau Testament, en particulier dans celui de Jean.
Évaluation critique
L’hypothèse de Marie comme nouvelle Ève est plus solide que celle de Marie comme nouvelle Rachel en raison des indices textuels explicites dans l’Évangile de Jean et du témoignage précoce des Pères de l’Église. L’utilisation du mot « femme » en Jean 2 et 19, le symbolisme vivifiant du vin et le rôle central de Marie dans le ministère de Jésus fournissent un cadre cohérent pour la considérer comme le pendant d’Ève. Contrairement au lien Rachel-Mary, qui s’appuie fortement sur des sources juives ultérieures et sur une seule citation dans Matthieu 2, le parallèle Ève-Mary est fondé sur les éléments linguistiques et thématiques de l’Évangile de Jean, renforcés par les écrivains chrétiens du deuxième siècle. Toutefois, l’absence de référence explicite à Marie en tant que nouvelle Ève dans le Nouveau Testament, combinée au silence de Paul sur cette typologie, met en garde contre toute exagération. Le lien est plus implicite que définitif, nécessitant une interprétation théologique pour combler le fossé.
Le défi méthodologique consiste à faire la distinction entre l’intention scripturale du premier siècle et le développement théologique ultérieur. Les interprétations des Pères de l’Église, bien que précoces, reflètent une herméneutique post-évangélique qui peut amplifier les allusions subtiles de Jean. Il est possible que l’utilisation par Jean du terme « femme » et du motif du vin évoque intentionnellement la Genèse, mais il est tout aussi plausible que ces éléments aient été interprétés plus tard comme tels par une Église cherchant à articuler la signification de Marie. Le contexte juif d’Ève comme Hava (qui donne la vie) et le contexte grec de Zoé renforcent l’argument, tout comme la symétrie narrative de la présence de Marie au début et à la fin du ministère de Jésus. Cependant, en l’absence d’une déclaration directe dans le Nouveau Testament, la typologie de la Nouvelle Ève reste une construction théologique plutôt qu’un mandat biblique concluant.
Conclusion
L’idée de Marie comme nouvelle Ève est un concept théologique riche et évocateur, étayé par des indices textuels dans l’Évangile de Jean, en particulier l’adresse de Jésus à Marie en tant que « femme » et le symbolisme vivifiant du vin à Cana et à la croix. Les premiers Pères de l’Église, de Justin Martyr à Augustin, témoignent de manière convaincante que cette interprétation est apparue dans le siècle qui a suivi la publication des Évangiles, ce qui suggère une tradition profondément enracinée. Si les écrits de Paul se concentrent sur Adam et le Christ sans mentionner Marie ou Ève dans un sens typologique, ils n’excluent pas la possibilité d’un parallèle entre Marie et Ève dans la théologie de Jean. Par rapport à l’hypothèse de Marie comme Nouvelle Rachel, le lien avec la Nouvelle Ève est plus solide en raison de son fondement textuel et historique. Cependant, elle reste un cadre d’interprétation plutôt qu’une déclaration scripturale explicite, invitant les lecteurs à explorer l’interaction profonde entre les conceptions juives et chrétiennes de la vie, de l’obéissance et de la rédemption.