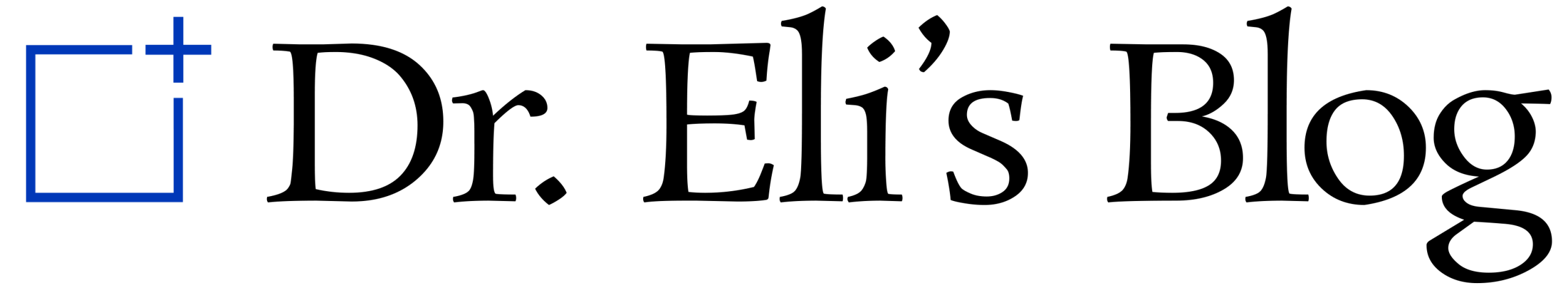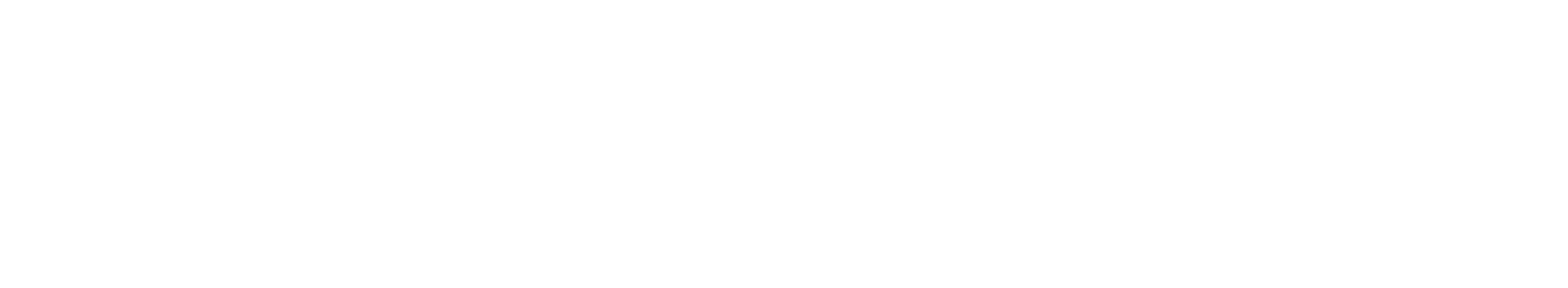Le « Notre Père », également connu sous le nom de « Notre Père », est la prière la plus emblématique et la plus chère du christianisme, récitée par des millions de personnes à travers les confessions et les cultures. Ses paroles, que l’on trouve dans Matthieu 6:9-13 et Luc 11:2-4, résonnent avec une profonde simplicité et une grande profondeur théologique. Pourtant, malgré sa place centrale dans le culte chrétien, nombreux sont ceux qui sont surpris d’apprendre que le « Notre Père » s’inspire de modes de prière et de thèmes théologiques juifs familiers. En examinant ses parallèles conceptuels et linguistiques avec les prières juives, nous découvrons une riche tapisserie de spiritualité partagée qui jette un pont entre le christianisme et le judaïsme. Cette exploration ne se contente pas d’éclairer les origines de la prière, elle nous invite également à apprécier les liens profonds qui unissent ces deux religions.
Le « Notre Père » et son noyau théologique
Le « Notre Père » est une prière concise mais complète qui résume des thèmes clés de la théologie chrétienne : La souveraineté de Dieu, sa provision, son pardon et sa protection. Le texte, tel qu’il est rapporté dans Matthieu 6:9-13, se lit comme suit :
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal »
La prière s’articule autour de deux images centrales de Dieu : Père et Roi. Ces deux rôles – Dieu en tant que parent aimant et souverain – façonnent les demandes de la prière, qui sollicitent la guidance divine, la subsistance, le pardon et la délivrance. Ce cadre théologique n’est pas propre au christianisme, mais trouve des parallèles frappants dans la liturgie juive, en particulier dans le concept d’Avinu Malkeinu (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ- « Notre Père, notre Roi »). Cette phrase, qui occupe une place centrale dans la prière juive, en particulier pendant les jours saints de Rosh Hashanah et de Yom Kippur, résume la même dualité entre l’attention intime et l’autorité majestueuse de Dieu.
Avinu Malkeinu : Un parallèle conceptuel
L’expression « Avinu Malkeinu » est plus qu’un titre poétique ; c’est une pierre angulaire théologique de la liturgie juive. Elle apparaît dans une série de prières suppliantes récitées pendant les jours de crainte, où la communauté s’adresse collectivement à Dieu comme à un père compatissant et à un roi juste. Les prières Avinu Malkeinu comprennent des demandes de pardon, de protection, de provision et de sanctification du nom de Dieu – des demandes qui reflètent la structure et le contenu du « Notre Père »
Par exemple, une ligne de l’Avinu Malkeinu se lit comme suit :
« Avinu Malkeinu, selach u-mechal l’chol avonoteinu. » (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ סְלַח וּמְחַל לְכָל חַטֹּאתֵינוּ)
« Notre Père, notre Roi, pardonnez et remettez tous nos péchés »
Cette demande de pardon ressemble beaucoup à la demande « Notre Père » : « Et remettez-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs » Les deux prières reconnaissent la fragilité humaine et sollicitent la miséricorde divine, soulignant une relation réciproque où le pardon de Dieu est lié au pardon de l’homme envers les autres. De même, l’Avinu Malkeinu comprend des demandes de subsistance et de protection, telles que
« Avinu Malkeinu, zochreinu l’chayim » (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ זָכְרֵנוּ לְחַיִּים)
« Notre Père, notre Roi, souviens-toi de nous pour la vie »
Cette phrase fait écho au « Notre Père » qui demande le « pain quotidien » et la délivrance du mal, reflétant ainsi une confiance partagée dans la provision et la protection de Dieu. La double adresse à Avinu (Père) et Malkeinu (Roi) dans la liturgie juive est parallèle à l’invocation de Dieu dans le « Notre Père » en tant que parent céleste dont le nom est sanctifié et dont le royaume est recherché. Les deux traditions soulignent la transcendance de Dieu (« qui est au ciel ») et son immanence (une attention paternelle pour les besoins humains). Cette concordance conceptuelle suggère que le « Notre Père » n’est pas une innovation chrétienne isolée, mais une prière profondément enracinée dans la conception juive de la nature de Dieu. Historiquement, la prière Avinu Malkeinu s’est développée après l’époque de Jésus (ses premières références apparaissent chez Rabbi Akiva à la fin du 1er et au 2e siècle de notre ère). Ainsi, si le thème théologique est authentiquement juif et antérieur au christianisme, la forme liturgique spécifique est plus tardive.
La Amidah (prière debout)
Au-delà de l’Avinu Malkeinu, le « Notre Père » présente des similitudes linguistiques et thématiques avec d’autres prières juives, telles que l’Amidah (la prière debout) et les Birkot HaShachar (les bénédictions du matin). Ces prières, qui occupent une place centrale dans le culte juif quotidien et festif, constituent une preuve supplémentaire de l’ascendance liturgique du « Notre Père ».
L’Amidah (הַעֲמִידָה), également connue sous le nom de Shemoneh Esrei (שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה – Dix-huit bénédictions), est l’épine dorsale des services synagogaux juifs, récités trois fois par jour. Ses demandes couvrent les thèmes de la sanctification, de la règle divine, du pardon et de la protection, éléments essentiels du « Notre Père » Par exemple, l’une des bénédictions de l’Amida se lit comme suit : « Nekadesh et shimim » :
« Nekadesh et shimcha ba’olam, k’shem shemakdishim oto bishmei marom » (נַקְדִּישׁ אֶת שִׁמְךָ בָּעוֹלָם, כְּשֵׁם שֶׁמַּקְדִּישִׁים אוֹתוֹ בִּשְׁמֵי מָרוֹם)
« Nous sanctifierons ton nom en ce monde, comme il est sanctifié en haut dans les cieux »
Cette phrase est étroitement liée au « Notre Père » « que ton nom soit sanctifié », ce qui reflète un désir commun d’honorer la sainteté de Dieu dans les domaines céleste et terrestre. Une autre bénédiction de l’Amidah demande le royaume de Dieu :
« M’loch al kol ha’olam kulo bichvodecha » (מְלֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ)
« Règne sur le monde entier dans ta gloire »
Cette phrase entre en résonance avec « Que ton règne vienne », exprimant une aspiration à la souveraineté universelle de Dieu. La Amidah comprend également des demandes de subsistance et de pardon, ce qui renforce le chevauchement structurel et thématique avec le « Notre Père »
Bénédictions du matin (Birkot HaShachar)
Les Birkot HaShachar (בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר), récitées quotidiennement par les juifs pratiquants, comprennent des expressions de gratitude et de supplication qui font écho au « Notre Père » L’une des bénédictions demande la protection contre la tentation et le mal :
« V’al tvi’einu lo l’ydei chet, v’lo l’ydei averah v’avon, v’lo l’ydei nissayon… v’al yishlot banu yetzer hara. » (וְאַל תְּבִיאֵנוּ לֹא לִידֵי חֵטְא, וְלֹא לִידֵי עֲבֵרָה וְעָוֹן, וְלֹא לִידֵי נִסָּיוֹן… וְאַל יִשְׁלֹט בָּנוּ יֵצֶר הָרָע)
« Ne nous soumets pas au pouvoir du péché, de la transgression, de l’iniquité, de la tentation… et que le mauvais penchant ne domine pas sur nous. »
Cette demande ressemble de manière frappante au « Notre Père » « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » Les deux prières reconnaissent la propension humaine à l’échec moral et recherchent la guidance divine pour éviter les pièges spirituels. Ce langage commun souligne une préoccupation théologique commune : la nécessité de l’intervention de Dieu pour relever les défis de l’existence humaine. Ces parallèles démontrent l’existence de thèmes et d’idiomes communs plutôt que d’emprunts directs. La proximité linguistique reflète la culture de la prière du judaïsme primitif, qui valorisait les supplications brèves, mémorisées et communautaires.
Contexte historique et culturel
Les racines juives du « Notre Père » sont éclairées par son contexte historique. Jésus, un maître juif du premier siècle, a adressé cette prière à ses disciples dans un milieu juif imprégné des traditions liturgiques de la synagogue et du Temple. Les Évangiles présentent le « Notre Père » comme faisant partie des enseignements de Jésus sur la prière (Matthieu 6,5-15 ; Luc 11,1-4), probablement destinés à guider ses disciples d’une manière compatible avec les pratiques dévotionnelles juives. La brièveté et la structure de la prière s’alignent sur les prières concises et mémorisées courantes dans la liturgie juive, telles que le Kaddish ou l’Avinu Malkeinu, qui ont été conçues pour être récitées en commun.
Le Kaddish (קַדִּישׁ), autre prière juive importante, partage également des éléments thématiques avec le « Notre Père » Bien qu’il s’agisse avant tout d’une doxologie louant le nom de Dieu, le Kaddish comprend des requêtes pour l’établissement du royaume de Dieu :
« Yitgadal v’yitkadesh shmei raba… v’yamlich malchutei » (יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא… וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתֵהּ)
« Magnifié et sanctifié soit son grand nom… qu’il établisse son règne »
Cette phrase est en résonance avec le « Notre Père », qui met l’accent sur la sanctification du nom de Dieu et la prière pour son royaume. Bien que le Kaddish ne soit pas une source directe du « Notre Père », l’accent qu’il met sur la sanctification et la souveraineté divines met en évidence l’environnement liturgique juif dans lequel le Notre Père a vu le jour. Le Kaddish est antérieur à la rédaction finale du Notre Père, mais pas nécessairement sous une forme identique. Tous deux reflètent probablement des motifs théologiques communs dans le judaïsme du Ier siècle, plutôt que de s’inspirer directement l’un de l’autre.
Un pont entre les traditions
Le « Notre Père » est un plan divin pour l’approche de Dieu par l’âme, rempli d’espoir dès son premier mot. Il nous apprend à nous présenter devant le Divin avec le cœur confiant d’un enfant et la révérence d’un sujet loyal. En appelant Dieu « Notre Père », nous revendiquons notre place dans sa famille, en sécurité dans son intimité et son amour. En déclarant son nom et son royaume sanctifiés, nous ancrons notre espoir dans son autorité ultime et sa volonté parfaite, confiants que sa bonté prévaudra.
Cette prière guide ensuite notre dépendance à l’égard de l’espérance. En demandant le « pain quotidien », nous apprenons à compter sur sa fidèle provision, libérant ainsi les angoisses du lendemain. En demandant le pardon, nous embrassons l’espoir libérateur d’une ardoise propre et d’un cœur adouci. Implorant la délivrance du mal, nous plaçons notre main dans la sienne, confiants qu’il est notre guide et notre protecteur.
Par conséquent, cette prière est plus que des mots ; c’est une invitation à une relation pleine d’espoir. Elle nous assure que nous sommes entendus, qu’il est pourvu à nos besoins et que nous ne sommes jamais seuls. Dans ses lignes intemporelles, nous trouvons le courage d’approcher le Créateur de l’univers, non pas avec crainte, mais avec la confiance pleine d’espoir d’un enfant bien-aimé qui rentre à la maison.