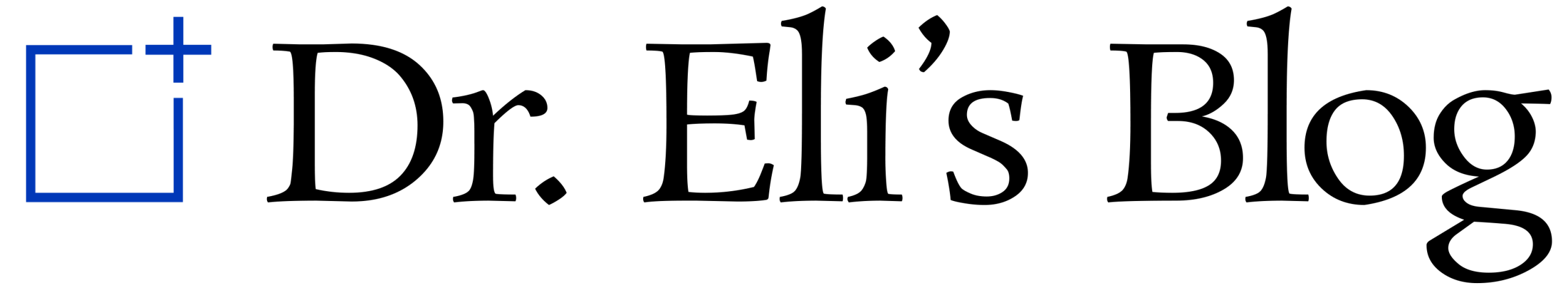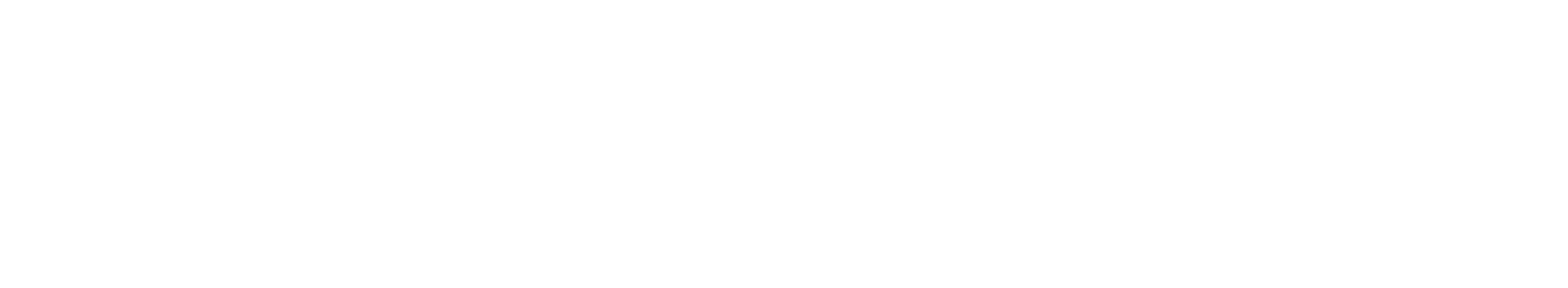La question de savoir qui Caïn a épousé, telle qu’elle est présentée dans Genèse 4:17, est l’une des énigmes les plus persistantes de l’érudition biblique et de la curiosité populaire. Le texte affirme que « Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoch », mais il ne fournit aucun détail explicite sur l’identité ou l’origine de la femme. Cette omission, qui s’inscrit dans le contexte d’un récit qui ne mentionne qu’Adam, Ève, Caïn, Abel et, plus tard, Seth, suscite une cascade de questions : Si Adam et Ève ont été les premiers humains et si Caïn a tué Abel, d’où vient la femme de Caïn ? Qui étaient les personnes dont Caïn craignait qu’elles ne le tuent (Gn 4,14) ? Et comment a-t-il pu construire une « ville » (Gn 4,17) avec une population aussi réduite ? Cet essai explore deux interprétations principales : l’interprétation traditionnelle, selon laquelle Caïn a épousé sa sœur, et l’interprétation non traditionnelle, qui suggère la possibilité que d’autres humains existent en dehors de l’Eden. Ces deux points de vue sont confrontés au texte biblique, à son contexte historique et à ses implications théologiques.
Le point de vue traditionnel : Caïn a épousé sa sœur
L’interprétation traditionnelle, profondément enracinée dans l’exégèse juive et chrétienne, soutient que la femme de Caïn était l’une de ses sœurs, une fille d’Adam et d’Ève. Ce point de vue découle de la croyance selon laquelle Adam et Ève ont été les seuls géniteurs de l’humanité, comme le suggèrent Genèse 3:20, qui appelle Ève « la mère de tous les vivants » (אֵם כָּל-חָי, em kol-chai), et Genèse 5:4, qui note qu’Adam « a eu d’autres fils et d’autres filles » au cours de ses 930 ans de vie. Étant donné qu’aucune autre origine humaine n’est mentionnée, la femme de Caïn est présumée être une sœur ou un frère, probablement né après la mort d’Abel ou non mentionné dans le récit épars.
Soutien biblique
Le point de vue traditionnel s’appuie sur plusieurs indices textuels. Genèse 5:4 indique qu’Adam et Ève ont eu d’autres enfants que Caïn, Abel et Seth, ce qui constitue un vivier de frères et sœurs potentiels. La longue durée de vie des premiers hommes – les 930 ans d’Adam (Gn 5,5), par exemple – suggère qu’il y a eu suffisamment de temps pour la croissance de la population. Les textes rabbiniques et ceux du Second Temple renforcent cette interprétation. Le livre des Jubilés (4,11), un texte du Second Temple, nomme explicitement la femme de Caïn comme étant sa sœur Awan, tandis que Genèse Rabba 22,7 implique des mariages mixtes entre les enfants d’Adam. Ces sources, bien qu’elles ne soient pas canoniques pour la plupart des chrétiens, reflètent les premiers efforts des juifs pour résoudre la question dans le cadre d’une origine humaine unique.
La séquence narrative de Genèse 4, 9-17 pose cependant des problèmes. Après que Caïn a tué Abel, Dieu le confronte et Caïn se lamente : « Quiconque me trouvera me tuera » (Gn 4,14, מִי שֶׁיִּמְצָאֵנִי יַהַרְגֵנִי, mi she-yimtza’eni yahargeni). Il s’installe ensuite à Nod, se marie et construit une « ville » nommée Enoch (Gn 4:17, וַיִּבֶן עִיר וַיִּקְרָא שֵׁם הָעִיר כְּשֵׁם בְּנוֹ חֲנוֹךְ, vayiven ir vayikra shem ha-ir k’shem b’no Chanokh). Le terme « ville » fait probablement référence à un établissement modeste, mais il implique tout de même une population supérieure à celle de Caïn et de sa femme. Le point de vue traditionnel explique cela en suggérant que les enfants et les petits-enfants d’Adam et d’Ève, qui n’ont pas été enregistrés, ont peuplé ces premières communautés au fil du temps.
Points forts et défis
La force du point de vue traditionnel réside dans sa simplicité et sa fidélité à l’affirmation apparente du texte d’une origine humaine unique. Le titre d’Ève en tant que « mère de tous les vivants » et l’accent généalogique mis sur la lignée d’Adam (Gn 5) soutiennent l’idée que tous les humains, y compris la femme de Caïn, descendent de ce premier couple. D’un point de vue théologique, cela correspond aux enseignements ultérieurs du Nouveau Testament, tels que l’affirmation de Paul dans Romains 5:12-19 selon laquelle le péché et la mort sont entrés par « un seul homme » (Adam), ce qui implique une lignée humaine unifiée.
Cependant, ce point de vue se heurte à des obstacles logistiques et narratifs. Genèse 4:9-17 se lit comme une séquence compacte, sans indication explicite que des décennies ou des siècles se sont écoulés entre la mort d’Abel, l’exil de Caïn et son mariage. Pour que Caïn puisse épouser une sœur, il faudrait qu’elle soit née et qu’elle ait atteint sa maturité, ce qui nécessite un laps de temps important auquel le texte ne fait pas allusion. La crainte de Caïn d’être tué par d’autres (Gn 4,14) soulève également des questions : Qui sont ces « autres » s’il ne reste que ses parents ? La réponse traditionnelle – qu’il s’agit de frères et sœurs ou de neveux nés plus tard – exige de supposer une croissance rapide de la population dans une courte fenêtre narrative, ce qui semble difficile compte tenu de la brièveté du texte.
Un autre défi est la question morale du mariage entre frères et sœurs. Si l’inceste est plus tard interdit par la loi mosaïque (Lv 18,9), la vision traditionnelle postule que de telles restrictions ne s’appliquaient pas à l’ère primordiale, les mariages mixtes étant nécessaires à la survie de l’humanité. Les préoccupations génétiques concernant la consanguinité sont souvent abordées en suggérant que les premiers humains, étant plus proches de la création originelle de Dieu, avaient moins de défauts génétiques, bien que cela soit spéculatif.
Le point de vue non traditionnel : D’autres humains au-delà de l’Eden
Le point de vue non traditionnel propose que la femme de Caïn provienne d’une population d’humains existant en dehors du jardin d’Eden, créée par Dieu avant ou en même temps qu’Adam et Eve. Cette perspective remet en question l’hypothèse selon laquelle Adam et Ève étaient les seuls géniteurs, suggérant au contraire que la Genèse se concentre sur leur rôle unique en tant que porteurs de l’image de Dieu dans un espace sacré (l’Éden), tandis que d’autres humains habitaient le monde en général.
Soutien biblique et contextuel
Ce point de vue s’appuie sur les ambiguïtés textuelles et le contexte culturel du public initial de la Genèse – les Israélites récemment libérés de l’esclavage égyptien. Genèse 1:26-27 décrit la création de l’humanité (אָדָם, adam) à l’image de Dieu, en utilisant le pluriel « Faisons l’homme à Notre image » (נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ, na’aseh adam b’tzalmenu). L’utilisation du pluriel (« Nous ») a suscité un débat : Dieu s’adresse-t-il à un conseil divin (Ps 82:1), à des anges, ou peut-être à d’autres humains déjà créés ? Certains chercheurs soutiennent que l’absence de l’article défini dans Genèse 1:26 (אָדָם, générique « l’humanité ») contraste avec sa présence dans Genèse 1:27 et 2:7 (הָאָדָם, ha’adam, « l’homme »), suggérant une distinction entre l’humanité dans son ensemble et la création spécifique d’Adam et Ève.
Le point de vue non traditionnel postule que la Genèse 1:26-27 décrit une création plus large de l’humanité, tandis que la Genèse 2:7-15 se limite à la formation unique d’Adam et Eve en Eden, un espace sacré probablement situé sur une montagne (Ez 28:12-13). Cela correspond aux visions du monde de l’ancien Proche-Orient, où les montagnes étaient considérées comme des points de rencontre entre le divin et l’humain. Si l’Eden était un lieu privilégié, d’autres humains auraient pu exister ailleurs, fournissant la femme de Caïn, les personnes qu’il craignait et la population de sa « ville »
Le contexte culturel étaye ce point de vue. La Genèse a été écrite pour les Israélites qui passaient de l’esclavage égyptien à la vie de l’alliance. En Égypte, seul le pharaon était considéré comme divin ou semblable à un dieu, les roturiers étant très éloignés de ce statut. La Genèse renverse cette situation en déclarant que tous les Israélites, par l’intermédiaire d’Adam et d’Ève, sont les porteurs de l’image de Dieu (Gn 1, 26-27). L’accent mis par le récit sur Adam et Ève peut donc être théologique, soulignant l’identité d’Israël, plutôt qu’un récit scientifique des origines humaines. Les Israélites, préoccupés par leur survie et leur loyauté envers Dieu, ne se souciaient probablement guère de savoir si d’autres humains existaient en dehors de leur histoire.
Considérations archéologiques et théologiques
Bien que le point de vue non traditionnel soit moins concerné par la science moderne, il trouve un écho dans les découvertes archéologiques. Les découvertes de Néandertaliens et d’autres hominidés, qui ont coexisté avec l’Homo sapiens et se sont peut-être croisés, suggèrent un arbre généalogique humain complexe. Bien que la Genèse ne parle pas de ces populations, le point de vue non traditionnel admet leur existence, interprétant la femme de Caïn comme un membre d’une communauté humaine plus large.
Sur le plan théologique, ce point de vue se heurte à des difficultés, notamment en ce qui concerne l’affirmation de Genèse 3:20 selon laquelle Ève est « la mère de tous les vivants » Les interprètes non traditionnels proposent deux réponses. Tout d’abord, le titre d’Ève peut être lié à une alliance, la désignant comme la mère de la lignée choisie par Dieu (comme Abraham en tant que « père d’une multitude de nations », Gn 17,5), et non de tous les humains sur le plan biologique. Deuxièmement, les textes du Proche-Orient ancien utilisent souvent des affirmations hyperboliques sur la lignée, et la Genèse peut également mettre l’accent sur Adam et Ève en tant que chefs représentatifs de l’humanité, et non en tant qu’uniques initiateurs.
Un obstacle plus important est la théologie de Paul dans Romains 5:12-19, qui lie le péché universel et la rédemption à Adam. Si d’autres êtres humains ont existé, comment le péché d’Adam les affecte-t-il ? Les spécialistes non traditionnels pourraient soutenir que le rôle d’Adam est représentatif et non biologique, à l’instar du rôle du Christ en tant que « second Adam » Toutefois, cela nécessite une navigation théologique prudente afin d’éviter de saper le cadre de Paul.
Points forts et défis
La force du point de vue non traditionnel réside dans sa capacité à combler les lacunes narratives sans nécessiter de sauts temporels spéculatifs. La femme de Caïn, sa peur des autres et sa ville s’expliquent facilement si d’autres humains ont existé. Elle s’aligne également sur l’accent théologique du texte sur l’identité d’Israël et évite les préoccupations modernes de précision scientifique, qui étaient étrangères au public d’origine.
Cependant, elle risque d’introduire une complexité qui n’est pas explicite dans le texte. La Genèse ne mentionne nulle part d’autres créations humaines, et le titre d’Ève en tant que « mère de tous les vivants » reste un contrepoint important. Ce point de vue exige également de réinterpréter des passages du Nouveau Testament, ce qui peut sembler difficile pour ceux qui sont attachés à une théologie biblique unifiée.
Synthèse et réflexion
Les deux points de vue sont confrontés à la tension entre la rareté du texte et le désir de clarté du lecteur. Le point de vue traditionnel préserve la simplicité d’une origine humaine unique, en accord avec Genèse 3:20 et Romains 5:12-19, mais se heurte à la chronologie comprimée du récit et à la peur de Caïn pour les autres. Le point de vue non traditionnel résout ces questions en proposant d’autres humains, offrant ainsi une lecture contextuelle riche pour le public d’Israël, mais il introduit des éléments spéculatifs et des complexités théologiques.
La distinction linguistique entre אָדָם (générique « l’humanité ») et הָאָדָם (« l’homme ») fournit une passerelle potentielle. Si Genèse 1:26 décrit une création humaine plus large et que Genèse 2:7 se concentre sur Adam et Ève, le point de vue non traditionnel gagne une assise textuelle. Cependant, le fait que la tradition massorétique conserve les deux formes pourrait simplement refléter une variation stylistique, et non une distinction théologique, ce qui laisse le débat ouvert.
En fin de compte, la question de la femme de Caïn transcende la simple curiosité historique. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous lisons les textes anciens, que ce soit en tant que modernes à la recherche de réponses scientifiques ou en tant que croyants embrassant un récit théologique. Le point de vue traditionnel nous ancre dans l’unité apparente du texte, tandis que le point de vue non traditionnel nous ouvre les portes d’une histoire humaine plus large, en résonance avec l’identité d’alliance d’Israël. Toutes deux appellent à l’humilité, en reconnaissant les limites de notre compréhension.
Conclusion
Le mystère de la femme de Caïn – qu’il s’agisse d’une sœur née d’Ève ou d’une femme issue d’une création humaine plus large – n’est toujours pas résolu, mais il nous incite à nous émerveiller de la profondeur de la Genèse. Le point de vue traditionnel offre une réponse directe, enracinée dans la paternité unique d’Adam et Ève, tandis que le point de vue non traditionnel imagine un monde au-delà de l’Éden, en accord avec les indices narratifs et le contexte d’Israël. Plutôt que d’exiger une réponse définitive, le texte nous invite à nous tenir dans l’admiration d’un Dieu qui tisse l’histoire de l’humanité à travers le mystère et le sens. En réfléchissant à la femme de Caïn, nous sommes amenés non pas à résoudre l’énigme, mais à faire confiance à Celui qui est à l’origine de tous les commencements, nous préparant à des mystères encore plus grands, comme les « fils de Dieu » et les « filles des hommes » de Genèse 6.