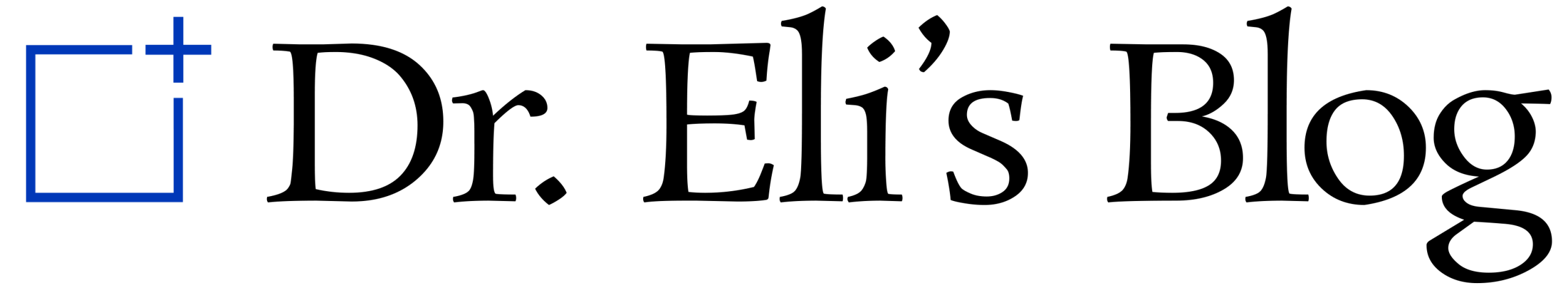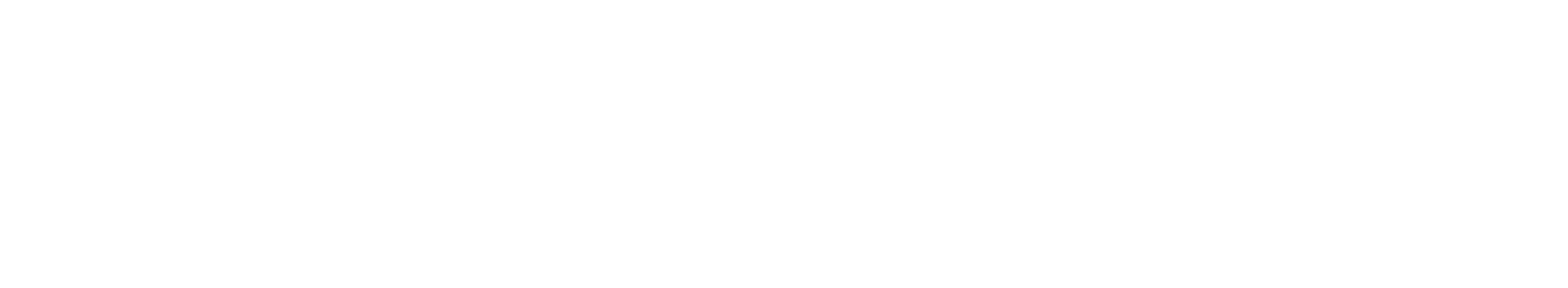La question de savoir si Marie, la mère de Jésus, peut être comprise comme une « nouvelle Rachel » dans la théologie chrétienne, en particulier dans un cadre catholique, est à la fois intrigante et complexe. Cette idée, explorée de manière proéminente par l’universitaire catholique Brant Pitre dans son livre Jesus and the Jewish Roots of Mary (2018), cherche à établir un parallèle entre la matriarche juive Rachel et Marie, la mère de Jésus, en situant Marie dans le concept juif des « mérites des pères » et le rôle de Rachel en tant qu’intercesseur puissant pour Israël. Bien que l’argument de Pitre soit convaincant et enraciné dans un engagement profond avec la tradition juive, il soulève des défis méthodologiques et interprétatifs qui méritent d’être examinés. Cet essai examinera les forces et les faiblesses de l’argument de Pitre, en discutant de l’idée juive des « mérites des pères », de la souffrance de Rachel et de son rôle d’aide dans la tradition juive, et des liens que Pitre établit entre Rachel et Marie, tout en examinant également si le Nouveau Testament soutient clairement cette comparaison.
Les mérites des pères et des mères dans la tradition juive
Le concept juif des « mérites des pères » (zechut avot)est essentiel pour comprendre le lien potentiel entre Rachel et Marie. Il fait référence aux actes justes des patriarches d’Israël – Abraham, Isaac et Jacob – qui confèrent des avantages spirituels à leurs descendants. Cette idée est à la base de la théologie juive de l’alliance, soulignant que la fidélité des patriarches continue d’influencer la relation de Dieu avec Israël. Par exemple, dans la Genèse 26:24, Dieu assure Isaac : « Je suis le Dieu de ton père Abraham ; ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance, à cause de mon serviteur Abraham » Cette promesse souligne l’impact durable de l’obéissance d’Abraham, en particulier sa volonté de sacrifier Isaac (Genèse 22), que la tradition juive considère comme l’acte de foi ultime.
Ce concept est également inscrit dans la liturgie juive, notamment dans la Amida, la prière centrale du culte juif, qui commence par invoquer le « Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob » et reconnaît que Dieu se souvient de la « pieuse fidélité des pères » qui ont apporté un rédempteur à leurs descendants. Cet accent liturgique démontre l’importance de l’alliance des mérites des patriarches. Il est intéressant de noter que l’apôtre Paul reprend cette idée dans Romains 11:28, en déclarant que même les Juifs qui rejettent Jésus restent « bien-aimés à cause des pères », ce qui illustre la présence de ce concept dans la pensée chrétienne primitive.
Si les « mérites des pères » se concentrent traditionnellement sur les patriarches masculins, la tradition juive élève également certaines matriarches, en particulier Rachel, en tant que figures dont la souffrance et la droiture contribuent à l’héritage spirituel d’Israël. La vie de Rachel, marquée par une profonde tragédie et l’abnégation, la positionne comme le pendant féminin des patriarches, dont les mérites sont invoqués dans des rôles d’intercession. Ce concept ouvre la voie à l’examen de la question de savoir si Marie, dans la théologie chrétienne, peut être considérée comme la continuation ou l’accomplissement du rôle de Rachel.
La souffrance de Rachel et son rôle d’intercession
La vie de Rachel, telle qu’elle est décrite dans la Bible hébraïque, est une tapisserie de douleur et de résilience. Son histoire commence par ses fiançailles avec Jacob, qui travaille sept ans pour l’épouser, avant d’être trompé par son père, Laban, qui lui substitue Léa lors de leur nuit de noces (Genèse 29). La souffrance émotionnelle de Rachel s’intensifie en raison de cette trahison et de sa stérilité prolongée, alors que Léa porte des enfants. Lorsque Rachel donne finalement naissance à Joseph, sa vie devient une autre source d’angoisse, puisqu’il est vendu comme esclave par ses frères (Genèse 37). L’ambiguïté entourant la mort de Rachel – avant ou après la mise en esclavage de Joseph – complique encore son récit. La Genèse 35:19 rapporte sa mort pendant la naissance de Benjamin, alors que la Genèse 37:10 suggère qu’elle était peut-être encore en vie pendant les rêves de Joseph, ce qui soulève des questions quant à l’ordre chronologique de ces événements.
La souffrance de Rachel atteint son apogée théologique dans Jérémie 31:15, où elle est dépeinte comme pleurant les exilés d’Israël : « Une voix se fait entendre à Rama, des lamentations et des pleurs amers. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d’être consolée pour ses enfants parce qu’ils ne sont plus » Ce verset fait de Rachel l’intercesseur maternel dont le chagrin transcende sa vie terrestre, et il est associé à Genèse 22 dans le cycle liturgique juif de Rosh Hashanah. La tradition rabbinique amplifie ce rôle, comme on le voit dans Genèse Rabba (82, 10), où Jacob enterre Rachel près de Bethléem pour que ses prières puissent intercéder en faveur des futurs exilés. Dans Lamentations Rabba (Petichta 24), l’intercession de Rachel surpasse celle d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Moïse, dont les appels à la restauration d’Israël sont rejetés par Dieu. L’appel de Rachel, fondé sur son sacrifice personnel – surmonter la jalousie pour accepter Léa – pousse Dieu à promettre : « Pour toi, Rachel, je rétablirai Israël à sa place » (Jérémie 31, 15-16). Ce portrait midrashique élève Rachel au rang d’intercesseur suprême, dont les mérites rivalisent avec ceux des patriarches, voire les dépassent.
Marie, nouvelle Rachel : l’argument de Pitre
Brant Pitre soutient que Marie, la mère de Jésus, incarne une « nouvelle Rachel » dans le Nouveau Testament, en particulier dans l’Évangile de Matthieu. Il identifie trois liens essentiels : premièrement, le massacre des innocents à Bethléem (Matthieu 2:16-18) a lieu près de la tombe de Rachel, ce qui permet de relier le contexte géographique des pleurs de Rachel à la présence de Marie ; deuxièmement, Matthieu cite explicitement Jérémie 31:15 pour décrire le deuil des enfants massacrés, ce qui suggère un lien typologique ; et troisièmement, Rachel et Marie souffrent toutes deux en raison du dessein divin de leurs fils, Joseph et Jésus. Pitre s’appuie sur des érudits juifs comme David Flusser, qui voit en Rachel le symbole de la mère juive souffrante, reflété par l’angoisse de Marie face à la persécution de Jésus, et Jacob Neusner, qui reconnaît en Marie catholique une « Rachel chrétienne » dont les prières résonnent de la compassion divine.
L’argument de Pitre est enraciné dans la tradition catholique de la théologie mariale, qui voit en Marie une intercesseuse et une corédemptrice, rôles parallèles à celui de Rachel dans la tradition juive. Le massacre des innocents, ordonné par Hérode pour éliminer la menace perçue d’un nouveau « roi des Juifs » né à Bethléem (Matthieu 2, 1-6), évoque les pleurs de Rachel pour ses enfants. La fuite de Marie en Égypte avec Joseph et Jésus (Matthieu 2, 13-15) l’associe encore davantage à la souffrance de Rachel, les deux mères endurant une douleur liée au destin de leurs fils. Pitre suggère que la citation par Matthieu de Jérémie 31:15 présente intentionnellement Marie comme une nouvelle Rachel, dont le chagrin maternel et le rôle d’intercesseur répondent aux attentes juives d’une figure matriarcale défendant le peuple de Dieu.
Une perspective critique
Bien que la thèse de Pitre soit évocatrice, elle se heurte à des difficultés importantes lorsqu’elle est examinée à la lumière des preuves historiques et textuelles. Le principal problème réside dans la datation et le contexte des sources juives citées par Pitre. De nombreux textes rabbiniques, tels que Genèse Rabba et Lamentations Rabba, ont été compilés des siècles après le Nouveau Testament, ce qui soulève des questions quant à leur pertinence pour l’interprétation des textes chrétiens du premier siècle, tels que l’Évangile de Matthieu. Ces traditions juives plus tardives peuvent refléter une réponse à la théologie mariale chrétienne plutôt qu’un cadre indépendant sur lequel Matthieu s’est appuyé. Par exemple, l’élévation de Rachel au rang d’intercesseur suprême dans les Lamentations Rabba pourrait être un contrepoint juif à la vénération croissante de Marie dans le christianisme primitif, qui s’est développée de manière significative aux troisième et quatrième siècles.
En outre, Matthieu 2,17-18 cite Jérémie 31,15 pour décrire le deuil des enfants de Bethléem, et non pas explicitement pour caractériser Marie. Le texte se concentre sur les pleurs de Rachel en tant que symbole du chagrin collectif juif, et non en tant que typologie directe de Marie. Si la proximité géographique de Bethléem avec la tombe de Rachel et le parallèle de la souffrance maternelle sont suggestifs, ils n’établissent pas de manière concluante que Marie est une « nouvelle Rachel » dans le texte lui-même. L’Évangile ne dépeint pas explicitement Marie intercédant ou pleurant dans ce contexte, contrairement au rôle actif de Rachel dans Jérémie et dans les midrashim ultérieurs.
Pour illustrer le défi méthodologique, considérons le cas parallèle de la « règle d’or » attribuée à Jésus (Matthieu 7:12) et à Rabbi Hillel (Shabbat 31a). Alors que tous deux énoncent un principe similaire – Jésus de manière positive (« Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils te fassent ») et Hillel de manière négative (« Ce qui t’est odieux, ne le fais pas à ton prochain ») – l’attribution talmudique à Hillel apparaît des siècles après Jésus. Cela soulève la possibilité que la tradition juive ait absorbé ou réattribué les enseignements chrétiens, ou que les deux aient puisé indépendamment dans des écritures juives communes. De même, les parallèles entre Rachel et Marie peuvent refléter une convergence ultérieure des théologiens juifs et chrétiens plutôt qu’une intention typologique directe dans l’Évangile de Matthieu.
Conclusion
La question de savoir si Marie est une « nouvelle Rachel » est une exploration fascinante des intersections théologiques juives et chrétiennes. L’argument de Brant Pitre, soutenu par des chercheurs comme Flusser et Neusner, met en évidence des parallèles convaincants : Cependant, le recours à des sources juives tardives et l’absence de preuves textuelles explicites dans l’Évangile de Matthieu empêchent de tirer des conclusions définitives. Si le rôle d’intercesseur de Rachel dans la tradition juive offre un cadre riche pour comprendre la signification de Marie dans la théologie catholique, le lien reste spéculatif en l’absence de sources juives antérieures ou contemporaines pour confirmer l’intention de Matthieu. La beauté de cette comparaison réside dans sa capacité à rapprocher les conceptions juive et chrétienne de l’intercession maternelle, mais elle doit être considérée comme une typologie possible, plutôt que définitive. Une exploration plus poussée des textes juifs du premier siècle et du développement de la mariologie chrétienne primitive pourrait encore clarifier la question de savoir si Marie émerge vraiment comme une « nouvelle Rachel » à l’époque du Nouveau Testament. Pour l’instant, le lien reste une question ouverte, invitant les lecteurs à évaluer les preuves et à décider par eux-mêmes. Pour consulter les autres articles de cette série, cliquez ici.