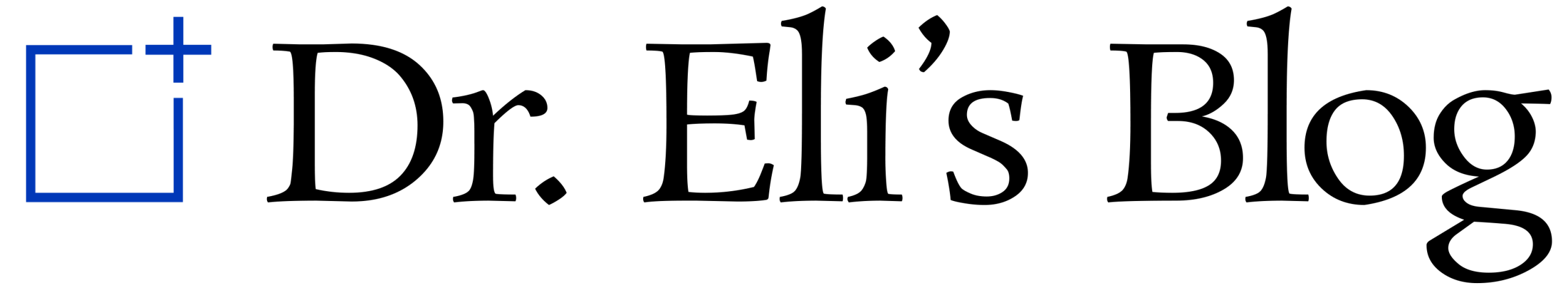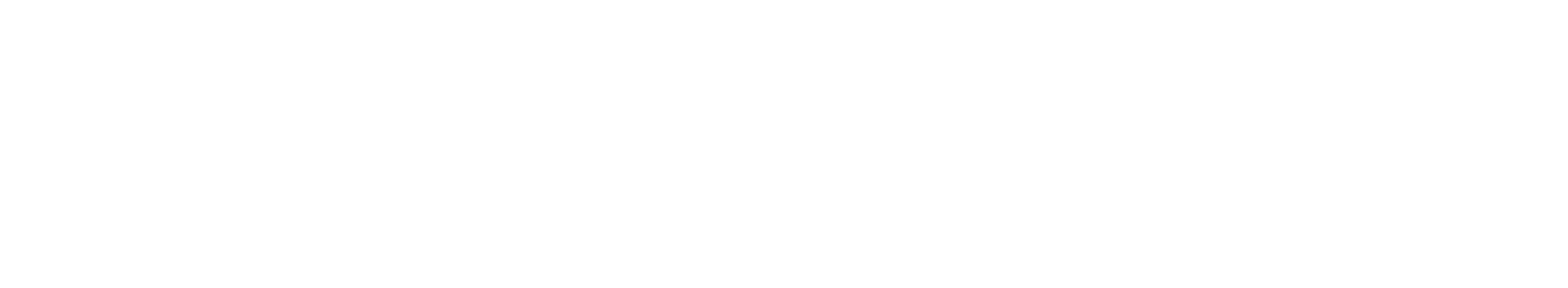Cet article est la deuxième partie d’un article portant le même titre et fait également partie d’un chapitre d’un livre plus vaste intitulé The Jewish Roots of Mary (Les racines juives de Marie) : Un regard différent sur la femme hébraïque emblématique.
Marie, nouvelle Rachel
Jusqu’à présent, nous avons vu que l’ancienne idée juive des « mérites des pères » inclut non seulement les pères mais aussi les mères de la foi. Nous avons vu comment, dans le judaïsme, une femme particulière a gagné une place très spéciale en devenant l’intercesseur principal pour le peuple d’Israël. Elle s’appelle Rachel, et elle a mérité cette réputation parce que, parmi toutes les femmes et certainement parmi toutes les mères de la nation d’Israël, la souffrance et la tragédie qu’elle a endurées étaient uniques.
En outre, le texte biblique clé autour duquel tournent toutes les spéculations et l’imagination religieuse est Jérémie 31:15, où le prophète déclare que même si Rachel est morte, elle continue d’intercéder pour les enfants exilés d’Israël d’une manière si puissante que sa voix est entendue par le Dieu d’Israël haut et fort.
L’Évangile de Matthieu, dans son tout début, raconte l’histoire de la naissance et de la survie de Jésus. Il s’agit d’une histoire assez célèbre, racontée et redite tant de fois qu’il n’y a aucune raison de la répéter ici. Je reprendrai donc ma discussion à partir d’un point particulier de cette histoire : lorsque Hérode apprend qu’il y a de fortes chances que dans une petite ville connue sous le nom de Bethléem, quelqu’un naisse qui pourrait un jour être le roi d’Israël (Mt 2:1-2). Dès qu’il l’apprend, Hérode agit de manière décisive et impitoyable.
Il est important de comprendre que Bethléem n’est pas seulement très proche de Jérusalem, mais que la rumeur veut qu’elle soit le futur lieu de naissance du Christ, le roi d’Israël. Si le lieu de naissance de Jésus avait été ailleurs qu’à Bethléem, ou peut-être au moins ailleurs qu’en Judée, Hérode n’aurait peut-être pas été aussi inquiet. Le nom de Bethléem fait naître un drapeau rouge dans l’esprit d’Hérode, et ses soupçons sont confirmés par des conseillers spirituels, qui ont la sagesse qu’il recherchait à ce sujet (Mt 2:4-6).
Parce que les mages – une caste d’hommes très instruits originaires d’un lointain pays oriental et spécialisés dans l’astronomie, l’astrologie et les sciences naturelles – affirment avoir vu son étoile, Hérode devient paranoïaque, à l’instar de toute personne désireuse de s’accrocher au pouvoir. Il comprend que tout ce que le peuple perçoit comme étant d’origine céleste ne survivra à aucun niveau de contrôle gouvernemental.
Hérode ne croit pas une seconde que le Christ, le roi d’Israël tant attendu, vient de naître à Bethléem. Mais il sait que si l’histoire des mages venus d’Orient, qui a tout d’une légende, est divulguée, elle alimentera les spéculations messianiques, ce qui pourrait l’écarter, lui ou son descendant, des affaires royales. Pour apaiser ses craintes, Hérode autorise l’assassinat en masse de tous les enfants de moins de deux ans nés dans les environs de Bethléem. Nous lisons dans Matthieu :
Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : On entendit à Rama une voix, des pleurs et un grand deuil. Rachel pleurait ses enfants. Et elle refusa d’être consolée parce qu’ils n’étaient plus. (Mt 2:17-18)
L’ange du Seigneur apparaît à Joseph et lui donne l’ordre d’évacuer Marie et Jésus de la province de Judée et de les emmener jusqu’au pays d’Égypte. C’est la première fois que l’intersession de Rachel tirée de Jérémie 31:15 est reliée d’une manière ou d’une autre à ce qui arrive directement à Marie dans Matthieu 2.
Brant Pitre combine brillamment ses engagements catholiques et ses recherches en études juives. Il a vulgarisé avec passion et compétence ce que d’autres avant lui avaient déjà dit : Marie est l’équivalent dans le Nouveau Testament de la Rachel de l’Ancien Testament. Dans son livre Jesus and the Jewish Roots of Mary, Brant Pitre suggère trois liens entre Marie et Rachel :
Premièrement, le massacre des enfants se produit à proximité de la tombe de Rachel. Marie accouche pratiquement à côté de la tombe de Rachel (Bethléem). Deuxièmement, l’intercession de Rachel est explicitement citée dans Matthieu 2:17-18. L’auteur de l’Évangile de Matthieu pense donc clairement qu’il y a un lien. Troisièmement, Rachel et Marie souffrent toutes deux de l’identité et du dessein de Dieu dans la vie de leurs fils Joseph et Jésus, respectivement. Brant Pitre cite David Flusser, l’un des derniers pionniers de la recherche sur le Jésus juif à l’Université hébraïque de Jérusalem :
« Dans Matthieu, Rachel est une figure symbolique de la mère souffrante, en l’occurrence la mère juive souffrante. Et la douleur de Rachel pour les enfants morts symbolise aussi la souffrance de Marie par rapport à son illustre fils »
Il cite également Jacob Neusner, sans doute l’universitaire juif le plus prolifique de ces dernières années, qui confirme que la Marie catholique doit être considérée en relation avec la Rachel juive :
« C’est pourquoi je peux trouver en Marie une chrétienne, une Rachel catholique, dont les prières comptent quand celles des grands hommes, des pères du monde, tombent à terre… Il n’est pas étonnant que lorsque Rachel pleure, Dieu l’écoute. Il n’est donc pas difficile pour moi de trouver en Marie cette amie sympathique et spéciale que les catholiques connaissent depuis 2 000 ans ! Ce n’est pas si difficile que cela. Alors, oui, si Rachel, pourquoi pas Marie ?
Écrit Brant Pitre :
« En effet, à un niveau très humain, il est facile d’imaginer Marie pleurant non seulement pour la persécution et l’exil de son propre fils, mais aussi pour la vie de tous les garçons qui ont été massacrés dans la tentative de tuer son enfant. »
Mon point de vue
Qu’est-ce que je pense de tout cela ? Bien que je sois un lecteur sympathique du travail de Brant Pitre, je ne suis pas encore persuadé que Pitre, Flusser et Neusner ont raison quant au type de lien qu’ils voient entre Matthieu 2 et Jérémie 31. Jusqu’à présent, ce que nous pouvons déduire de manière vérifiable de Matthieu 2, c’est que Rachel, la matriarche d’Israël, était très engagée dans l’intercession non seulement pour le peuple juif exilé à Babylone, mais aussi pour les garçons juifs assassinés par la brigade des tueurs d’Hérode à l’époque de l’enfant Jésus. Le chapitre 2 de l’Évangile de Matthieu ne permet pas de déterminer si Marie y est représentée comme l’équivalent dans le Nouveau Testament de la Rachel de l’Ancien Testament.
Je suis prêt à voir si d’autres preuves, qui ne se fondent pas uniquement sur la citation de Jérémie 31 par Matthieu, montreront le lien entre Marie et Rachel en tant qu’homologues de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais pour l’instant, du moins à mes yeux, le lien n’est pas encore certain.
Aussi convaincants que soient les citations et les arguments de Brant Pitre, je reste ouvert mais non convaincu.
Permettez-moi de faire une brève pause dans la discussion sur les racines juives de Marie et de porter votre attention sur la discussion sur le Jésus juif afin d’expliquer mes problèmes avec les arguments de Pitre. Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus donne un enseignement qui sera connu dans l’histoire sous le nom de « règle d’or » 12 Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car c’est là la Loi et les Prophètes. (Matthieu 7:12). Le rabbin Hillel, que les textes juifs rabbiniques situent quelques siècles avant Jésus, aurait dit : « Ce qui t’est odieux, ne le fais pas à ton prochain. C’est là toute la Torah ; le reste en est l’explication – va l’étudier ! (Shabbat 31a)
La base de chaque texte est un effort pour résumer toute la Torah, englobant des centaines de commandements positifs(mitzvot aseh) et négatifs(mitzvot lo taaseh) en un seul principe de base. Les deux hommes donnent la même réponse, mais Jésus l’énonce de manière positive (en nous disant ce qu’il faut faire) et Hillel de manière négative (en nous disant ce qu’il ne faut pas faire). En fin de compte, cependant, il s’agit d’une seule et même idée.
Pourtant, nous devrions toujours nous demander : comment savons-nous que Jésus a dit cela, et quand l’a-t-il dit ? Nous savons qu’il l’a dit parce que cela est rapporté dans les Évangiles, et nous savons que les Évangiles ont été écrits au cours du premier siècle. Mais comment savons-nous que Hillel a dit ce qu’il a dit ? Nous le savons parce que la déclaration est conservée dans le Talmud. Cela signifie que le document dont nous tirons l’identité de la personne à laquelle la « règle d’or » est attribuée pour la première fois a été écrit/codifié/rédigé au moins 400 ans après Jésus ! Voyez-vous le problème ? Oui, Hillel a vécu plus de 100 ans avant Jésus, mais le dicton est attribué à Hillel 400 ans après les événements de Jésus.
Dans ce cas, ne se pourrait-il pas que Jésus soit l’auteur original de la « règle d’or », mais comme les disciples juifs de Jésus étaient fortement intégrés au reste de la société juive, cette idée a pu être acceptée dans le judaïsme non messianique par leur intermédiaire ? On peut presque imaginer une discussion des premiers rabbins débattant de la question suivante : « Ne fais pas à autrui ce que tu n’as pas fait :
« Ne fais pas aux autres ce qui t’est odieux, qui a pu dire cela ? » « Cela ne ressemble pas à Shammai ; peut-être était-ce Hillel ? » « Oui, très probablement. Attribuons-lui cette parole »
Il ne fait aucun doute que cette discussion imaginaire n’a pas eu lieu. Mais l’idée qu’Hillel est l’auteur originel de la « règle d’or » est peut-être correcte. Toutefois, compte tenu du problème que posent nos sources, l’interprétation aurait pu se faire dans un sens ou dans l’autre.
Il existe cependant une autre possibilité d’interprétation, selon laquelle Hillel et Jésus sont parvenus à leurs conclusions indépendamment l’un de l’autre, parce qu’ils s’appuyaient sur les mêmes Saintes Écritures ! Après tout, ils se sont tous deux abreuvés au même puits profond de l’ancienne tradition juive. A ce stade, vous vous dites peut-être : « Intéressant, mais quel est le rapport avec notre discussion sur Marie et le judaïsme ? Mais ne voyez-vous pas ? Cela a tout à voir.
Le problème, c’est que toutes les fabuleuses citations de la tradition juive que Brant Pitre a citées, par rapport aux évangiles, sont des sources très tardives. D’ailleurs, une conclusion plausible pourrait-elle être que les sources juives précitées témoignent d’une pratique apparue dans le judaïsme bien plus tard, en réponse à l’exaltation mariale dans la théologie chrétienne ?
En d’autres termes, l’identité de Rachel en tant qu’intercesseur peut en fait avoir été influencée par la mariologie, et n’a donc été documentée que plus tard. De telles possibilités montrent que les sources juives tardives n’ont qu’une valeur très limitée dans l’interprétation des sources juives anciennes (comme le Nouveau Testament). Nous ne devrions donc nous fier qu’aux sources juives antérieures ou à peu près contemporaines des événements de Jésus.
Il en va de même pour les citations de ces deux poids lourds des études juives que sont Flusser et Neusner. Eux aussi établissent à juste titre de magnifiques parallèles entre les idées juives de Rachel, grande matriarche d’Israël et puissante intercesseur, et Marie, Mère de Jésus et de tous les chrétiens, grande intercesseur des fidèles, comme le comprennent et le croient les chrétiens catholiques du monde entier. Il ne fait aucun doute que la Rachel juive et la Marie chrétienne ont beaucoup en commun, mais est-ce qu’elles l’avaient déjà à l’époque du Nouveau Testament ? Ou peut-être l’Église a-t-elle d’abord développé la théologie mariale au cours des trois premiers siècles, ce qui a permis à la théologie juive de s’opposer plus tard à l’alternative de la Rachel. La réponse est oui. Cela signifie qu’il est bon de connaître le lien possible entre Rachel, la matriarche d’Israël, et Marie, la matriarche de l’Église, mais pour l’instant, cela devrait rester juste cela, un lien magnifique mais seulement possible.